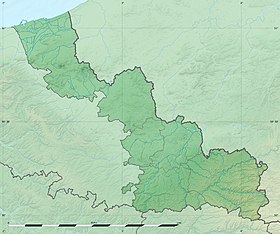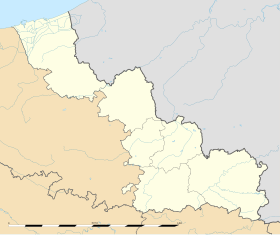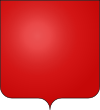Douai
| Douai | |
 La Scarpe à Douai, quai du Petit Bail. | |
 Blason |
 Logo |
| Administration | |
|---|---|
| Pays | |
| Région | Hauts-de-France |
| Département | Nord (sous-préfecture) |
| Arrondissement | Douai (chef-lieu) |
| Intercommunalité | Communauté d'agglomération du Douaisis (siège) |
| Maire Mandat |
Frédéric Chéreau 2014-2020 |
| Code postal | 59500 |
| Code commune | 59178 |
| Démographie | |
| Gentilé | Douaisiens |
| Population municipale |
40 736 hab. (2014) |
| Densité | 2 410 hab./km2 |
| Population agglomération |
552 694 hab. |
| Géographie | |
| Coordonnées | 50° 22′ 17″ nord, 3° 04′ 48″ est |
| Altitude | Min. 16 m Max. 38 m |
| Superficie | 16,90 km2 |
| Élections | |
| Départementales | Douai |
| Localisation | |
| Liens | |
| Site web | www.ville-douai.fr |
| modifier |
|
Douai est une commune française du département du Nord et de la région Hauts-de-France, située dans le sud de la Flandre romane.
Douai est au centre de l'aire urbaine de Douai-Lens, la quinzième aire urbaine de France, comprenant 103 communes, avec 542 918 habitants en 2010. Avec Lille et les villes de l'ancien bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, elle appartient aussi à un ensemble métropolitain de près de 3,8 millions d'habitants, appelé « aire métropolitaine de Lille ».
Les habitants de Douai sont les Douaisiens. La région s'appelle le Douaisis.
Le nom jeté des habitants est les « ventres d'osier » (vint' d'osier en chti) en raison de la matière dont sont faits les géants locaux (la famille Gayant).
Géographie
Situation
La ville de Douai est très proche de grandes capitales européennes comme Bruxelles (à 140 km et à 1 h 40 min de trajet), Paris (à 190 km, reliée en moins d'une heure en TGV) ou Londres (à 290 km). La ville est située à environ 38 km de Lille (37 minutes de trajet) entre Arras, Cambrai et Valenciennes. Les communes limitrophes sont : Lambres-lez-Douai, Waziers, Sin-le-Noble, Dechy, Cuincy, Auby, Lauwin-Planque, Flers-en-Escrebieux. Douai est la ville la plus méridionale de Flandre, à la limite avec l'Artois.

L'agglomération de Douai est traversée par la Scarpe, un affluent rive gauche de l'Escaut, le quartier de Dorignies possède un port pour la batellerie.
La ville de Douai est une commune entièrement urbanisée. Elle est composée de zones résidentielles de différentes époques. On voit cohabiter des quartiers nobles et bourgeois du XVIIIe siècle avec des quartiers populaires de l'époque des charbonnages. Son centre politique se situe dans la partie ancienne. L'hôtel de ville et son beffroi le symbolisent. Depuis la création de la communauté d'agglomération du Douaisis (CAD), un certain nombre de décisions sont partagées avec les 35 autres communes de l'agglomération.
Les axes de communication sont nombreux à Douai et font d'elle une ville carrefour. La gare occupe une place importante dans cette organisation. La ville est aussi un maillon du réseau de bus EVEA (Bus à Haut Niveau de Service) et le réseau de transport urbain (SMTD).
Communes limitrophes
Voies de communication
Transports ferroviaires
La ville de Douai dispose d'une gare SNCF permettant de relier Paris en une heure grâce au TGV (8 allers-retours origine Valenciennes) mais aussi des liaisons directes vers Lyon, Marseille, Bordeaux, Quimper, Brest, La Rochelle (uniquement les samedis estivaux), Strasbourg, Bruxelles (Belgique), Hendaye, Irun (Espagne), et les Alpes pendant la saison hivernale à savoir la Tarentaise (Bourg-Saint-Maurice), la vallée de l'Arve (Saint-Gervais-les-Bains) et la Maurienne (Modane). Les douaisiens peuvent également rejoindre Bourg-Saint-Maurice les samedis d'été.
Lille est à vingt minutes de Douai en TER.
Le projet de tramway Douai-Guesnain
Le tram de Douai est en réalité un système de bus circulant sur voie propre improprement appelé tramway.
Le Syndicat mixte des transports du Douaisis (SMTD) réalise un projet d'autobus à guidage magnétique au sol, entre Douai (Cité technique) et Guesnain.
Le SMTD a préféré prendre de l'avance et a donc déjà mis en place des nouvelles infrastructures, comme la distribution des nouveaux tickets (et la fin des anciens), les nouveaux tarifs ainsi que les nouvelles cartes à puce et magnétiques qui remplaceront tout le réseau actuel TAD'Evéole.
Il circule sur une voie réservée en béton dans laquelle ont été implantés, tous les 4 mètres, des plots magnétiques protégés par de la résine qui émettent des signaux « lus » par le véhicule au moyen d'un système informatique embarqué.
La ligne A, longue de 12 kilomètres, dessert 21 stations distantes d'environ 400 mètres les unes des autres. Avec une fréquence de 10 minutes en heure de pointe, il transporte 900 voyageurs par heure.
Dix rames de 18 mètres et 2 rames de 24 mètres sont en service. Elles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, grâce au plancher bas intégral et aux stations ajustées à leur hauteur, mais aussi aux personnes dont la vue est déficiente.
Ces rames sont propulsées par un moteur à gaz ou un système hybride. Le système fonctionne sans caténaires.
Le montant de l'investissement s'élève à 110 millions d'euros hors taxes. Il est aussi prévu la construction de la ligne B pour 2011 et des lignes C et D vers 2020.
L'extension de la ligne A se terminera en 2016, reliant les communes de Lewarde, Masny, Ecaillon et Auberchicourt jusqu'à Aniche (lycée Edmond-Laudeau) d'une part, d'autre part jusqu'à la cité des Blocs Jaunes à Douai. La ligne A sera la plus grande ligne de transports en commun du réseau ÉVÉOLE, s'étalant sur près de 20 kilomètres.
Son nom : Evéole[1].
Fin 2015, les rames du "tram ÉVÉOLE" sont mises à l'arrêt et remplacées par 16 bus articulés (ÉVÉA). Le système de guidage électromagnétique n'a jamais pu être testé ni même validé et les véhicules s'avèrent mécaniquement peu fiables. Une enquête est en cours sur des soupçons de favoritisme[2].
Toponymie
Le toponyme n'est connu que par des formes médiévales dont les origines sont obscures. Il s'agit peut être d'une formation toponymique gauloise ou gallo-romane en -acum, suffixe marquant la localisation ou la propriété. Le premier élément Do-, Du- doit représenter le nom de personne gaulois Dous[3].
Dans les sources historiques avérées, le nom de la localité est attesté sous les formes Doac (monnaie mérovingienne), Doacense [castellum] en 975, Duaci (génitif) en 1024, Duuaicum, Duuuaicum vers 1040, Duacum en 1035 - 1047, Duacum en 1051, Duacum en 1076 et en 1080 - 1085, Duachum en 1108, Duai en 1194, Doai en 1204, Douai apparaît pour la première fois en 1223[4]. En néerlandais : Dowaai[5].
Histoire
Héraldique
Les armes de Douai se blasonnent ainsi : « De gueules plain. » |

Origines de la cité
Douai est une création récente, médiévale, découlant de conditions naturelles singulières mais surtout de sa position de charnière entre le royaume de France et le comté de Flandre.
Au contact de deux régions qu’oppose la nature de leurs sols, perméable au sud, imperméable au nord, un éco-système marécageux – le bassin de la Scarpe – accueillit à l’époque mérovingienne de rares activités humaines qui allaient prendre dans les siècles suivants, par la volonté des comtes de Flandre, une dimension régionale exceptionnelle[6].
Sur un ilot de ce cours d’eau, originellement de faible débit, près du gué qui permettait le franchissement, se fixèrent divers bâtiments publics marquant l’autorité comtale. Deux noyaux de peuplement de part et d’autre de la Scarpe, aujourd’hui Place St Amé et Place d’Armes, constituèrent dès lors les points de développement de la ville. Très tôt, un déséquilibre apparut. La ville basse se développa plus rapidement autour du « Castel bourgeois » et des différents marchés placés au carrefour des axes Lille-Arras et Lens-Valenciennes[7].
Le riche Moyen Âge douaisien
La période médiévale fut pour Douai une période de grande prospérité découlant de ses activités commerciales (la vente des grains) et artisanales (la draperie) mais aussi de l’autonomie octroyée par le Comte de Flandre qui donnait à la ville le pouvoir de se gérer elle-même. La cité comptait à son apogée de 10 à 15 000 habitants.
La captation de Vitry
La première mention de Douai (Castellum Duacum, propriété des comtes de Flandre) qui fait entrer Douai dans l’histoire date de 930. Erigé par Baudouin II de Flandre, un « castrum », simple tour en bois, affirme son autorité sur ces lieux. Peu après, son successeur Arnoul Ier de Flandre fait construire un premier lieu de culte, la collégiale Saint-Amé.
C’est à cette époque enfin, qu’une dérivation du cours de la Sensée vers la Scarpe est aménagée à Vitry en Artois. Ce chantier, qui mobilise de nombreuses ressources humaines et financières, fut sans doute l’œuvre de l’autorité comtale mais sans qu’aucune certitude ne puisse être apportée sur ce point[8].
Quoi qu’il en soit, cet aménagement – complété par une seconde captation à Arleux un siècle plus tard – qui fut couronné de succès, façonna jusqu’à aujourd’hui la physionomie de la Scarpe. Gagnant en débit, il fut dès lors possible d’augmenter son trafic mais surtout d’installer sur son cours de nombreux moulins (plus de 16 au XII° siècle à partir de l’entrée des eaux) permettant, outre une mécanisation des activités artisanales, d’apporter à la ville par divers droits un financement conséquent[9].
Le droit d’étape pour la vente des grains
Situé au cœur d’un terroir agricole d’une grande richesse, Douai disposa à partir de 1301, par concession du roi Philippe le Bel, d’un droit d'étape, soit le privilège du commerce des grains dans la région. Au Moyen-Age, en effet, la navigation du nord vers le sud s’arrête à Douai, point le plus proche des grandes régions céréalières de France (ainsi l’Artois, le Cambraisis, le Santerre). Concentrés dans la cité, les grains (essentiellement du blé et de l’orge pour la bière flamande) sont alors exportés vers Gand, centre régulateur du marché des céréales jusqu’à la Baltique.
Amenée à Douai par l’exportateur qui gérait le transport jusqu’à la ville, la marchandise était stockée dans les bateaux ou dans des greniers sur la Scarpe tandis que le vendeur apportait sur le marché – place d’Armes actuelle – un échantillon du grain qu’il proposait aux éventuels acheteurs, pour la plupart flamands. La transaction effectuée, des bateliers – cette fois-ci souvent douaisiens – acheminaient la marchandise jusqu’aux ports gantois.
La taxation intervenait tout au long de ces étapes. Ce privilège, qui devint avec le temps la principale ressource de la ville (les dépenses pour les fortifications ou le beffroi terminé en 1475 furent largement assurées par ces taxes), était un droit vital que Douai défendit farouchement jusqu’au XVII° siècle. La ville condamnait les fraudeurs (qui tentaient de passer par d’autres cours d’eau, ainsi la Lys) mais surtout menait des procès contre toutes les villes qui régulièrement essayaient de la concurrencer (Arras, Béthune ou Lens). De même, l’attention portée à la navigabilité du fleuve resta extrême afin de pouvoir accueillir des navires de forts tonnages. Pour cette raison, l’entretien des quais comme les opérations de drainages étaient réguliers. La sécheresse de 1458 fut pour la ville une catastrophe. Cette année-là, la baisse du niveau de la Scarpe rendit impossible tout transport[10].
Si la défense du privilège fut souvent victorieuse, la ville était en revanche impuissante contre les nombreux aléas qui perturbaient à cette époque le commerce des grains. Les guerres en France pouvaient y ruiner les récoltes tandis que les troubles politiques des pays du Nord ne manquaient pas d’empêcher leurs importations. De même, à une échelle géographique plus limitée mais beaucoup plus fréquente, toute crise frumentaire conduisait les autorités à bloquer les grains dans les villes et à en empêcher l’exportation[11].
La draperie
Moins rémunérateur pour la ville que le commerce des grains mais surtout moins durable, la draperie est toutefois emblématique de l’âge d’or de Douai qui, avec Bruges, Gand, Ypres et Lille, sera à ce titre comptée parmi les cinq « bonnes villes » de Flandre. Selon Georges Espinas[12], si cette production est apparue dès la création de la cité, c’est au XIII° siècle qu’elle atteignit son point haut. Employant de très nombreux artisans, mobilisant de forts capitaux, la draperie douaisienne s’est répandue dans toute l’Europe, parfois très loin, en Russie (marché de Novgorod), sur les confins de la Baltique mais aussi en Italie comme dans la péninsule ibérique.
Cette activité reposait sur un puissant mais fragile équilibre entre les patrons ou les échevins - qui d’ailleurs se confondaient souvent - et les producteurs. Le dynamisme de cette bourgeoisie innovante s’exprime par l’activité législative du Magistrat – les bans - dont l’objectif est d’abord de produire des draps d'une qualité élevée toujours égale (les contrôleurs de la ville, les « égards » apposent des sceaux de cire ou de plomb sur les pièces autorisées au commerce). Les mêmes principes de fabrication, de vente, d’embauche, de concurrence s’imposent dans tout le territoire de la cité. Ils feront le succès de la draperie douaisienne.
La célèbre figure de l’entrepreneur Jehan Boinebroke, découvert dans les archives douaisiennes par Espinas, a permis de mieux connaître les conditions sociales et techniques de la production drapière. Ainsi, les conditions d’achat de la laine aux abbayes anglaises comme la vente des draps finis dûment contrôlés, en passant par toutes les étapes de finition du produit. Etoffe de laine, le drap, après l'ourdissage dont la solidité des fils de chaîne conditionne la qualité du produit, est tissé en sergé (d’où les petits chevrons de la trame). Il connait ensuite plusieurs transformations dont le foulage qui donne à l'étoffe son aspect feutré, le tondage durant lequel le tissu est débarrassé des brins de fil qui dépassent et enfin la teinture avec des colorants naturels, guède ou garance. Le produit exporté, qui servira à confectionner des vêtements de luxe, est une pièce qui peut mesurer 20 à 30 mètres[12].
L’équilibre social qui était à la source du succès de la draperie douaisienne se rompt à la fin du XIII°. Les crises qui se succèdent (les « takehans », grève et émeutes qui opposent les patriciens – bourgeois et entrepreneurs – aux artisans tisserands) affaiblissent la production alors même que l’environnement économique mais surtout politique se modifie durablement. Douai, dès lors, ne parvient pas à s’adapter à la concurrence de produits moins luxueux (la sayette lilloise entre autres) qui inondent le marché. Dès le XV°, la draperie douaisienne, en perte de vitesse, ne compte plus dans les échanges européens[13].
La liberté et la loi de Douai
Il existe un débat entre historiens quant à l’origine des libertés communales douaisiennes. Certains estiment qu’elle est une sorte de création « naturelle » dès le XI° siècle émanant d’hommes libres qui se sont organisés collectivement à partir de ce statut personnel, ensuite avalisée par le Comte de Flandre[12]. D’autres considèrent qu’il s’agit d’une initiative de ce dernier, soucieux de renforcer la cité et de s’attacher ses habitants. Quoi qu’il en soit, la date exacte d’apparition de cette coutume n’est pas connue, même si on s’accorde à penser que Philippe d'Alsace, comte de 1157 à 1191, l’a probablement sanctionnée. Ainsi, la première mention écrite du texte concerne une décision comtale accordant en 1188 à Orchies « la liberté et la loi de Douai », sachant qu’une version écrite, transformant peut être la coutume en charte, a été accordée par Ferrand du Portugal en 1228.
Le pouvoir local dépend à l’origine de seize échevins, tous égaux, cooptés selon un système de désignation à plusieurs degrés. Ces institutions seront modifiées régulièrement (1297, 1311, 1368, 1373 etc.) [7]. Cette succession de réformes, outre de démontrer que l’organisation politique n’était pas satisfaisante, visait aussi avec le temps à donner un peu plus de pouvoir au commun au détriment du patriciat. Quelques principes resteront toutefois préservés jusqu’à la Révolution. Ainsi l’impossibilité pour les échevins sortant d’être réélus ou l’inéligibilité liée à certains degrés de parenté (gendre, cousin etc.). La représentation répond à la logique paroissiale (six à Douai) mais aussi à celle des quartiers (escroette) mais ne concerne que les bourgeois. Les manants[14] comme les forains[15] sont exclus du pouvoir par définition.
L’action scabinale s’exprime d’abord par les bans, très nombreux au XIII° siècle, régissant, outre les activités artisanales, toute l'édilité de la ville, les fossés et les remparts, l'état des rues et des maisons. Ainsi, pour lutter contre les incendies qui pouvaient prendre des dimensions catastrophiques, les bans avaient prévu l’aménagement de « flégards », passages raccordés à la Scarpe permettant de puiser l'eau en cas de besoin. De même, douze « wettes » étaient chargés du guet de nuit pour détecter le plus tôt possible les départs de feu. Enfin, vers 1250, les échevins décrétèrent que toutes les maisons neuves seraient couvertes de tuile et non plus de chaume afin de mieux résister aux flammes. Sur un autre plan, furent institués les « tuekin » chargés de tuer les chiens errants (parfois jusqu'à cent par mois)[16].
Les échevins ont très tôt le souci d’inscrire leur pouvoir dans des actes et lieux symboliques, face au châtelain ou son bailli qui incarnent une présence comtale toujours concurrente. Plusieurs repères sont ainsi remarquables : le sceau de la ville créé en 1201, la halle - palais municipal surmonté du beffroi au siècle suivant - en 1205, le premier chirographe en 1224, le premier ban en 1229. Du point de vue juridique, la ville s’est attribuée peu à peu le pouvoir de justice, haute et basse, laissant au bailli les seules garde des prisonniers et exécution de la sentence[17]. Quant au plan politique, les échevins ne manquèrent pas de prendre parti lors des conflits qui allaient se succéder entre le comte et le roi de France tout au long du Moyen Âge.
Comtes de Flandre contre rois de France
Jusqu’en 1369, Douai comme Arras, est une cité frontalière que se disputent le roi de France et le comte de Flandre. Avant cette date, qui marque jusqu’au XVII° siècle le retour définitif à la Flandre, la ville change de maître plusieurs fois. Elle connaît d’abord une alternance entre la France et le Hainaut, puis entre ce dernier et la Flandre, et devient même pendant les guerres franco-flamandes, sous Philippe-Auguste, Louis VIII et Saint-Louis, une possession royale (traités d’Athis-sur-Orge en 1305 et le traité de Pontoise en 1312).
La position du Comte de Flandre auprès de son puissant voisin, complexe, ne manque pas d’avoir des conséquences sur la ville. Ainsi, à plusieurs reprises est affirmée la suzeraineté du roi sur la Flandre et l’obligation faite aux Douaisiens de prendre son parti en cas de trahison du comte. Quoi qu’il en soit, Douai remplit fidèlement son rôle de bonne ville de Flandre en participant aux guerres avec l’envoi de ses milices à l’ost flamand (sept fois au XIII° siècle), en contribuant au financement des croisades et en soutenant régulièrement le comte en cas de difficulté.
Avec un certain brio, les échevins savent habilement tirer parti de ces fluctuations. A chaque changement de tutelle, le maintien des coutumes est confirmé par les nouveaux maîtres soucieux de maintenir la prospérité de la cité frontière. Sous Philippe Le Bel, en 1297, deux clans s'opposent, les « Clauwaerts » partisans du comte et les « Léliaerts » partisans du roi. Ce conflit se double d’un affrontement entre les commerçants et les petits artisans, qui sont pour le lion, et les grands bourgeois drapiers qui eux soutiennent la fleur de lys. D’abord victorieux, les premiers cèdent la place aux seconds quand Philippe le Bel réussit à écraser ses adversaires à Mons en Pévèle en 1304, victoire qui donne Douai à la France pour un demi-siècle[7].
La guerre de Cent ans mais plus encore des alliances matrimoniales successives affaiblissent cet équilibre. En 1369, Charles V, qui marie son frère Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, à la fille du comte de Flandre Louis de Male redonne à ce dernier la ville de Douai. Cette décision, suivie de nombreuses péripéties guerrières, conduit peu à peu à détacher la cité du royaume de France. Passée en effet dans l’orbite d’un duché de Bourgogne de plus en plus puissant, l’enjeu que constitue sa position de ville frontière culmine lors des guerres qui opposent Louis XI à Charles le Téméraire. En 1479, suivant de peu la mort du duc, l’échec des troupes royales devant la porte d’Arras[18] atteste de la solidité du nouvel équilibre que le mariage de Marie de Bourgogne avec Maximilien d’Autriche vient de fonder. Dès lors possession des Habsbourg, Douai allait connaître sous Charles Quint mais surtout Philippe II un dynamisme nouveau.
Douai ville impériale et catholique, du XVe au XVIIe siècle
Le déclin que connaît Douai à la fin du Moyen-Age conduit à un changement profond de sa fonction urbaine. Son rattachement aux Pays-Bas espagnols vont durablement fonder sa position de ville administrative et militaire[7].
La religion dans la ville
La religion, inséparable de Douai, est organisée pour le séculier en six églises paroissiales dont deux collégiales (Saint Amé et Saint Pierre). La ville accueille dans ses murs de nombreuses et importantes congrégations religieuses (Franciscains en 1230, Dominicains en 1232, Trinitaires en 1252 pour les hommes, Abbaye des Près en 1218, Filles de Saint Thomas en 1479 pour les femmes).
Cette présence s’est associée aux refuges installés dans la cité par les monastères du plat pays, toujours soucieux de disposer d’un lieu de sûreté en cas de guerre mais aussi de pouvoir apporter de l’aide auprès des habitants les plus démunis. Les plus célèbres étaient le « Constantin » des bénédictins de l’abbaye de Marchiennes, devenu Parlement de Flandre, ou le collège d’Anchin, futur collège des Jésuites, dépendant de l’abbaye du même nom située à Pecquencourt.
Un avant-poste de la contre-réforme
Dans la contre-réforme catholique, Douai exprime sa fidélité, comme son orthodoxie, ainsi que le prouvent les fondations de couvents qui apparaissent aux XVI° et XVII° siècles (entre autres, les Jésuites en 1568, Les Carmes en 1615, les Augustins en 1621, les Filles de Sainte Agnès en 1580, les Filles de Saint Julien en 1581 etc.). On en comptera à la veille de la Révolution près d’une quarantaine (7% des Douaisiens, peut être le double en ne considérant que les adultes, sont des clercs en 1706).
Cette « invasion conventuelle »[19] soutenue par l’empereur, est toutefois difficilement acceptée par le Magistrat, sinon les habitants, peu favorables à une évolution qui, outre son coût, transforme leur cité en ville d’étudiants et de religieux tout en y affaiblissant la proportion de bourgeois et d’artisans, catégories sociales sur lesquelles la puissance de Douai reposait autrefois[7].
Douai, refuge des catholiques anglais
Le rôle le plus visible que Douai joue dans la stratégie impériale de contre-réforme, outre la création de l’université, est le soutien qu’elle apporte au mouvement missionnaire catholique destiné aux Etats passés au protestantisme, principautés allemandes, Provinces-Unies mais surtout royaume d’Angleterre.
L’installation des Bénédictins anglais (1603) et des Récollets anglais (1616) font suite à la fondation - en 1568 et à l’initiative du cardinal Allen - d’un collège dédié à la formation des prêtres catholiques d’outre Manche et dont les études s’associent aux cours de l’université. C’est au collège anglais de Douai que fut achevée, en 1609, la traduction anglaise de la Bible, connue sous le nom de « bible de Douai »[20], dont allaient se servir les « prêtres du séminaire », souvent martyrs de la foi[21].
La fondation de l’université
Depuis 1425 existait en Flandre une université renommée, Louvain. Située dans une région de langue thioise, les étudiants français éprouvaient des difficultés à y suivre les cours. Le projet de création à Douai, soutenu en partie par le magistrat, fut longuement mûri par les empereurs, Charles Quint qui n'y était pas favorable et Philippe II qui prit le parti contraire. Le roi dut cependant affronter l’opposition décidée de l’université louvaniste qui ne voyait pas d’un bon œil l’arrivée d’une rivale à ses portes mais aussi arbitrer les propositions concurrentes d’autres villes (Maubeuge, Valenciennes, Lille).
En 1562, Philippe II, avec le soutien des papes Paul IV et Pie IV, fonde l'Université de Douai. Professeur et évêque, Jean Vendeville prit une part importante dans cette décision. Il réussit à convaincre le monarque de l’utilité de cette implantation inspirée par la réforme tridentine et qui serait un vaste séminaire inculquant aux prêtres une foi aussi solide que prosélyte[22].
Drainant les étudiants de langue française qui n’avaient plus la tentation d’aller étudier dans une France alors suspecte d’hérésie, s’appuyant sur les nombreuses congrégations et collèges déjà installés dans une ville aux ressources étendues, l’université de Douai[23] rassemble dès sa fondation cinq facultés (théologie, droit canon, droit civil, médecine et arts libéraux), huit collèges, quatorze refuges d’abbaye, vingt-deux séminaires ainsi que toute la variété des imprimeries et des librairies que peut alimenter une telle floraison[24].
Un avant-poste éloigné des princes espagnols
Comptant jusqu’à mille étudiants, l’université de Douai, qui avait comme point fort son enseignement des mathématiques et celui de la théologie, n’atteignit pourtant jamais l’éclat de ses prestigieuses concurrentes, en dépit de sa fidélité au Saint-Siège et plus encore de son attachement aux Habsbourg. Cette soumission, qui ne se démentit jamais, fut de fait assez peu remerciée tant les prébendes comme les pensions furent rares pour soutenir son fonctionnement[25].
Dans la même logique, hors cette unique création universitaire, Douai fit l’objet d’un intérêt assez fluctuant sinon faible de la part des princes. On compte peu de séjours en ville durant leurs règnes ainsi qu'aucune création d’institution importante sur la période à l’inverse de Lille qui reçut du Duc de Bourgogne la chambre des comptes et surtout Gand qui devint le siège du conseil de Flandre[26]. De même, le droit d'étape fut atteint au cœur lorsque la canalisation de la Scarpe de Douai vers Arras fut décidée par Philippe II en 1595.
Le rattachement de Douai à la Flandre, qui avait dans une certaine mesure protégé la ville des destructions de la Guerre de Cent Ans, se retourne quand les conflits embrasent l’Europe du Nord à partir de 1618. En 1635, la déclaration de guerre de Richelieu à l’Espagne plonge la région dans la ruine. En 1640, quand Arras devient française, les armées royales sont aux portes de Douai. En 1667, après une série d’affrontements entrecoupés de courtes accalmies, c’est une ville ruinée, dépeuplée et exsangue que Louis XIV conquiert.
Douai sous l’Ancien Régime français
Redevenue française, Douai affirme sous l’Ancien Régime sa position de ville judiciaire, universitaire et militaire.
De la conquête de 1667 à l'annexion définitive en 1713
En 1667, le roi de France Louis XIV envahit la Flandre. Douai est assiégée et prise en trois jours par Vauban[27], qui attaque simultanément Lille[28]. Les combats furent brefs entre une garnison réduite à peu de chose et une armée française précédée par sa réputation de puissance. Le traité d'Aix-la-Chapelle (1668) annexe la Flandre à la France.

Dès lors, Douai va s'intégrer vers le nord au rideau de défense du royaume. Vauban propose de simples améliorations aux fortifications existantes. Il rajoute ici ou là demi-lunes, saillants et glacis mais surtout exploite à fond la ressource hydraulique qui peut, en inondant les fossés de la ville, l’isoler totalement. Il apporte aussi l’infrastructure qui manquait à la place, ainsi des casernes (ancien collège de Marchiennes), un arsenal (ancien prieuré Saint Sulpice) et une fonderie de canons, édifiée à l’emplacement de l’ancien château des comtes de Flandre.
La guerre de succession d’Espagne oppose à partir de 1701 la France à l'Angleterre, les Provinces-Unies et l'Autriche. D’abord, favorable, le conflit se retourne après la défaite de Ramillies en 1706 mais plus encore lorsque le duc de Marlborough se rend maître des Pays-Bas espagnols en 1709. L’année suivante, en avril, à la suite de l’indécise bataille de Malplaquet, les Alliés assiègent Douai mise en défense par l’énergique Comte d’Albergotti. Le siège connaît son point haut lors du « déluge de feu » qui, les 18, 19, 20 mai 1710, s’abat sur la cité. Toutefois la résistance, acharnée, dure jusqu’au 26 juin quand, avec les honneurs de la guerre, les troupes royales capitulent.
Comme à Lille, le départ des Français, souhaité par la plupart des habitants qui espèrent la restauration des libertés communales malmenées depuis 1667, va décevoir. Sous l’autorité avide du Comte de Hompesch, protestant, la domination hollandaise s’avère en effet dure à supporter. Ville de front, Douai doit assurer coûte que coûte l’entretien de sa garnison. Après sa victoire à Denain en juillet 1712, le maréchal de Villars reprend la cité le 8 septembre. Cette reconquête, confirmée par la Paix d’Utrecht, ne sera plus menacée avant 1914.
La reconstruction selon le Goût Français
La ville, ainsi que son plat pays, sortent ravagés d’un conflit de près d’un demi-siècle. Soucieux d’éviter l’anarchie dans la reconstruction qui s’annonce, les échevins édictent le célèbre « règlement de 1718 » qui fixe l’apparence des nouvelles demeures. Outre l’alignement sur la rue et la limitation de leur hauteur, la façade des maisons doit être homogène. Cette reconstruction, qui donne jusqu’à présent au centre de Douai une remarquable unité architecturale, exprime un « goût français » qui s’épanouit tout au long du siècle.
Ainsi, les rez-de-chaussée des bâtisses doivent être obligatoirement une « gresserie », soit montés en grès, matériau dont la résistance à l’humidité est extrême. Certains Douaisiens, quand ils en ont les moyens, l’utilisent même sur la totalité de la façade. Dans le cas contraire, le déploiement en hauteur (sur un ou deux étages) s’organise en hautes fenêtres dont les arcatures et les jambages sont en pierre de calcaire (extraites des carrières d’Avesnes le Sec) tandis que les trumeaux, en briques au calepinage soigné, supportent un badigeon de chaux colorée. Les corniches et les cordons, dont le profil peut s’alterner selon les étages, visent à empêcher l’écoulement de l’eau de pluie sur les murs. Le toit à forte pente, protégeant parfois un grenier à deux étages, doit être couvert de tuiles ou d’ardoises[29].
La ville reconquise, comme le montre le plan relief de Douai de 1709, était d’une apparence toute flamande. Le « retournement des toitures » allait la faire disparaître en quelques décennies. Le règlement de 1718 prévoit en effet que les anciennes maisons, dont la petite façade au fronton à la hollandaise donne sur la rue, soient remplacées par des constructions avec un axe principal inversé. Ce choix, qui apparaît aux Français plus rationnel, permet en effet, de regrouper éventuellement plusieurs maisons sous le même toit et favorise l’évacuation des eaux tout en simplifiant le dessin des charpentes[30].
Le Parlement de Flandre
Tirant la leçon des erreurs commises après la conquête de 1667, le roi répond aux aspirations des Douaisiens en installant dans la ville en 1714, le Parlement de Flandre qui n’est plus, certes, la cour des Pays-Bas français mais celle de la plus petite province du royaume, la Flandre française.
D’abord installé à Tournai en 1668, le parlement avait été transféré à Cambrai en 1709 lors de la guerre de succession d’Espagne. Au retour de la paix, Douai ne ménage pas sa peine pour que le roi l’implante dans la cité. Jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, cette installation, conquise de haute lutte, sera considérée comme « ce qu’il y a de plus remarquable en ceste ville ». La Cour est installée, au pied de la Scarpe, au « Grand Constantin », refuge de l’Abbaye de Marchiennes, après des aménagements importants dont témoigne l’apparat des salles d’audience conservées jusqu’à aujourd’hui[31].
Les magistrats veillent au respect dans le royaume des us et coutumes de la province. Si, durant sa courte existence (moins d’un siècle), le Parlement défend les particularités du droit flamand (ainsi entre autre le droit d’héritage des bâtards) et la singularité juridique de la Flandre (ainsi la restriction du droit d’évocation), la province connaîtra avec le temps une inexorable assimilation au droit français, évolution que les réformes de la Constituante sanctionneront définitivement en 1790[32].
Les piliers de la prospérité douaisienne
Avec l’installation du Parlement de Flandre, la ville profite durant le XVIII° siècle d’une incontestable prospérité à laquelle contribuent deux autres institutions qui façonnent à leur tour et durablement son profil urbain, sinon social : l’université et l'armée.
A la suite de la conquête, Louis XIV avait maintenu l'université mais l’alma mater douaisienne se révèle plus remuante qu’elle l’avait été au siècle précédent, notamment durant la crise janséniste et la célèbre « fourberie de Douai ». En 1744, les 2000 étudiants douaisiens se partagent pour les trois quarts dans la faculté des arts et pour l’autre quart en théologie ou en droit. Dix ans plus tard, la décision du gouverneur des Pays-Bas autrichiens, Charles de Lorraine, d’interdire à ses sujets, afin de favoriser Louvain, d'étudier et d’enseigner à Douai, réduit la faculté à sa seule dimension nationale. La fin de l’Ancien Régime sera donc celle d’un déclin accentué par l’expulsion, en 1764, des Jésuites du royaume, congrégation qui jouait un rôle central dans l’organisation des études[33].
Bastionnée sur tout son pourtour, Douai est dotée de nombreuses casernes, d’arsenaux, d’écoles militaires (la première de France, d'artillerie, fut créée par Louis XIV en 1679), d’un hôpital (l’Hôtel-Dieu fondé par le Magistrat en 1628, transformé en hôpital militaire en 1756) et même d’une fonderie de canons réputée. Cette place de première importance connaît donc dans ses murs une présence militaire massive. Au début du XVIII° siècle, près de 5 000 hommes et 1500 chevaux peuvent y loger (sur une population totale estimée à 12 000 habitants). Pour autant, les effectifs permanents sont en moyenne plus bas, aux alentours de 2 000 soldats. L’Etat-Major, dirigé par un gouverneur, a la haute main sur la discipline et la police de la garnison parfois au détriment des autorités municipales[34] qui, de plus, assument le coût du logement des officiers (soit par un hôtel mis à disposition, soit par une indemnité qui est à Douai de 1800 livres par an pour le seul gouverneur)[35].
L’organisation sociale à la veille de la révolution
A la fin de l’Ancien Régime, après plusieurs décennies d’influence française, Douai s’est profondément transformée comme le montre l'évolution du Magistrat. Si son rôle s’accentue sur la gestion de la ville, les finances locales et qu’il conserve la gestion du « tribunal des petits désordres »[36], le système de désignation des échevins est largement amoindri. Il est possible au gouverneur ou l’intendant de Lille de récuser les indésirables tandis que depuis 1716 leurs électeurs sont exclusivement les membres du Parlement, de l’Université, de la Gouvernance et des Chapitres[37]. Cette stratégie, qui vise à exclure les bourgeois et plus encore les entrepreneurs de la direction des affaires, se renforce avec l’installation du Parlement.
Les conseillers, qui sont nobles quand ils ne sont pas anoblis par l’achat de leur charge, constituent en effet une élite dont la puissance est sans concurrence dans la cité, à l'exemple des parcours du président Pollinchove mais surtout de Calonne, ministre de Louis XVI, dont le rôle aux prémices de la Révolution sera déterminant pour le royaume. A cette aristocratie s'agrège enfin à la périphérie les bourgeois qui, diplômés de la faculté, exercent près de la Cour des professions juridiques (avocats, notaires, huissiers, greffiers etc.). Cette fusion s'accélère jusqu'en 1789 par la vénalité des charges, combattue par le Parlement lors de la conquête mais que le roi a toutefois imposée.

A côté de ce groupe, le clergé, dont les membres sont fort nombreux (plus de mille en 1750), tient une place éminente, d’abord par la richesse foncière de ses congrégations installées en ville mais aussi par son rôle dans le fonctionnement des institutions universitaires. Enfin, les officiers de l’armée royale, souvent issus de la noblesse et qui, habitués à la mobilité, s’intègrent assez facilement à une élite locale dont ils partagent par ailleurs bien des traits[38].
Douai entre les murs est donc à la fin de l’Ancien Régime est une ville administrative aussi riche que socialement marquée. Si l’élite parlementaire, aristocratique et religieuse compte pour environ 10% de la population, la petite bourgeoisie de commerçants et d’artisans relativement prospère en regroupe environ 60 %. Le reste, un bon tiers, est constitué de la masse des journaliers ou de domestiques dont la précarité, évidente, est toutefois atténuée par les secours qu’ils peuvent recevoir en cas de besoin dans cette ville aussi puissante que bien organisée[39].
Douai sous la Révolution et le XIX° siècle
Entre 1790 et 1794, Douai a absorbé Wagnonville aujourd'hui dont une partie est mise en Réserve naturelle du Marais de Wagnonville.
Après la Révolution française, le Parlement et l'université sont supprimés. Le chef-lieu du nouveau département du Nord est établi à Douai en 1790 avant d'être déplacé en 1803 à Lille.
En 1802, le Consulat décide la création du lycée de Douai, actuellement lycée Albert-Châtelet, un des sept lycées de première génération avec les lycées de Bordeaux, Marseille, Lyon, Moulins, Bruxelles et Mayence.

La révolution industrielle démarra avec le chemin de fer et la construction de la ligne de Paris-Nord à Lille (1846), sur laquelle Douai était une gare importante. En 1878, l'école des maîtres ouvriers mineurs, future École des Mines de Douai est ouverte. L'exploitation minière fut organisée par la Compagnie des mines de l'Escarpelle qui exploitait la houille dans ses fosses nos 4 - 4 bis et 5 à partir des années 1870 ainsi que la Compagnie des mines d'Aniche qui a ouvert la fosse Bernard dans les années 1910. L'exploitation charbonnière cessera en 1970 avec la fermeture de la fosse no 5.
Le démantèlement des remparts de la ville est décidé en 1891. Il donne lieu à d'importants aménagements urbains dont la création de la Place du Barlet sur l'ancienne place du marché aux bêtes et la mise en service d'un réseau de tramway. Avec l'implantation de l'hippodrome[40] régissant les axes de composition de ce nouvel espace qui sera bordé à l'Est du Parc Charles-Bertin s'étendant dans les fossés et ouvrages défensifs extérieurs. En 1895, le canal de la Scarpe est ouvert, et Douai devient le second nœud fluvial français après Conflans-Sainte-Honorine.
- Douai pendant la Première Guerre mondiale
-
La rue de Paris vers 1918, incendiée par l'armée allemande.
-
Évacuation de Douai, le 2 octobre 1916, sous prétexte d'un nouveau « bombardement » des Alliés (photo d'archive allemande).
-
Destruction d'une des écoles chrétiennes de Douai, 2 octobre 1917 (8 morts), photo de propagande accusant les Alliés d'être responsables de ces morts.
-
Place d'Armes (photo d'archive allemande).
Douai subit d'importants dommages pendant les deux guerres mondiales. La gare et son quartier furent entièrement détruits en mai 1940. Le 11 août 1944, un important bombardement, allié celui-ci, cible également la gare mais occasionne d'importantes destructions dans toute la ville, faisant 279 morts[41].
L’ancien tramway de Douai est supprimé en 1950.
Alexandre Miniac, un urbaniste, est mandaté par le secrétariat d'État à la reconstruction en 1948 pour s'occuper de la ville de Douai, qui lui est redevable de son plan d'aménagement et de reconstruction après les dommages de la Seconde Guerre mondiale. Son plan est conservé aux archives municipales de Douai[42], exposé au musée de la Chartreuse en 1999.
Après la Seconde Guerre mondiale, les mines de charbon furent nationalisées, et Douai devint le siège des Houillères du bassin de Nord-Pas-de-Calais, et le resta jusqu’à la fin de l'activité houillère dans les années 1980. Douai a profité du développement de l'industrie liée au charbon, mais subit ses séquelles, et en particulier les affaissements miniers qui nécessitent des pompages continuels afin que la ville ne soit pas noyée.
En 1978, Douai inaugure la nouvelle place aux jets d'eau (place d'Armes).
Politique et administration
Tendances politiques et résultats
Liste des maires
Situation administrative

Canton de Douai-Nord
Canton de Douai-Nord-Est
Canton de Douai-Sud-Ouest
Canton de Douai-Sud.
Liste des conseillers généraux sur la ville de Douai
Douai est chef-lieu de quatre cantons :
| Conseiller général | Canton | ||
|---|---|---|---|
| Jacques Michon | Douai-Nord | ||
| Erick Charton | Douai-Nord-Est | ||
| Christian Poiret | Douai-Sud-Ouest | ||
| Alain Bruneel | Douai-Sud |
Jumelages
 Harrow (Royaume-Uni)
Harrow (Royaume-Uni) Recklinghausen (Allemagne)
Recklinghausen (Allemagne) Kenosha (États-Unis)
Kenosha (États-Unis) Dédougou (Burkina Faso) depuis 2003
Dédougou (Burkina Faso) depuis 2003 Puławy (Pologne) depuis le
Puławy (Pologne) depuis le  Seraing (Belgique)
Seraing (Belgique)
Population et société
Démographie
Évolution démographique
L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir du , les populations légales des communes sont publiées annuellement dans le cadre d'un recensement qui repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de plus de 10 000 habitants les recensements ont lieu chaque année à la suite d'une enquête par sondage auprès d'un échantillon d'adresses représentant 8 % de leurs logements, contrairement aux autres communes qui ont un recensement réel tous les cinq ans[46],[Note 1].
En 2014, la commune comptait 40 736 habitants, en diminution de −4,06 % par rapport à 2009 (Nord : 1,21 %, France hors Mayotte : 2,49 %).
Pyramide des âges
Petite enfance
- Crèche municipale Jean-Mabuse
- Crèche
Enseignement
Écoles maternelles
- École maternelle Bernard-de-Lattre
- Institution Saint-Jean
- École saint Nicolas
- École maternelle Saint-Joseph
- École maternelle Saint-Vincent de Paul
- École maternelle Madame-de-Sévigné
- École maternelle La Mouchonnière
- École maternelle Jean-de-La-Fontaine
- École maternelle Leclerc-de-Hautecloque
- École maternelle Jules Mousseron
Écoles primaires
- École Jean-Andrieu - Parent
- École Jean-Jaurès
- École Notre-Dame
- École Régionale 1er Degré Bateliers Forains
- École La Solitude
- École Jules-et-Léon-Maurice
- École Ferdinand-Buisson
- École Eugène-Lenglet
- École Saint-Joseph
- Institution Saint-Jean
- École François-Lemaire
Collèges
- Le collège Sainte-Clotilde (construit en 1866 auparavant Couvent des Dames de Flines puis École normale de filles)
- Le collège Albert-Châtelet
- Le collège André-Streinger
- Le collège Saint-Jean
- Le collège Jules-Ferry
- Le collège Gayant
- Le collège André-Canivez
Lycées
- Le lycée Jean-Baptiste-Corot de Douai est l'héritier de Downside, un ancien collège de moines bénédictins anglais, chassés d'Angleterre par la réforme anglicane (de 1536 à 1540), Thomas Cromwell ayant supprimé tous les monastères à cette époque.
- Le lycée Albert-Châtelet, créé en 1802, est l'un des sept lycées de première génération créé par le Consulat.
- Le Lycée Edmond-Labbé, créé en 1959, est un lycée général et technique situé rue Bourseul, près du faubourg de Béthune.
- L’Institution Saint-Jean, école privée catholique, accueille les élèves de la maternelle jusqu'aux classes préparatoires HEC. Ses classes prépas ont une renommée nationale.
- Le LEGTA de Douai-Wagnonville occupe le site d'un ancien château à Wagnonville et les bâtiments de l'ancienne université en centre-ville.
- Le Lycée Internat d'Excellence de Douai, sur une partie de l'ancien site de l'IUFM
Enseignement supérieur
- Le lycée Albert-Châtelet comporte des classes préparatoires scientifiques (BCPST 1 et 2, PCSI, MPSI, PC, PSI et MP) et littéraires (hypokhâgne et khâgnes B/L et A/L).
- L'Université d'Artois, héritière de l'Université de Douai créée en 1562, a son pôle de sciences juridiques et politiques situé à Douai depuis .
- L'École nationale supérieure des techniques industrielles et des Mines de Douai depuis 1878 : École des mines de Douai.
- L'École supérieure du professorat et de l'éducation du Nord-Pas-de-Calais a l'un de ses centres à Douai, dans les locaux des anciennes Écoles normales d'instituteurs (filles et garçons).
Héritier des écoles normales dont l'origine remonte à 1834, le site est aujourd'hui toujours en activité pour préparer le concours de professeur des écoles, en lien avec les réalités du terrain. ([51] Son excellence pédagogique lui permet d'obtenir régulièrement les meilleurs résultats de l'académie (pour vérifier ses pourcentages de réussite s'adresser aux directions de l'université d'Artois www.univ-Artois.fr, et de l'IUFM Nord Pas de Calais www.lille.iufm.fr)
- DBS - Douai Business School, École supérieure de vente industrielle internationale. Créée en 1991 par la Chambre de commerce et d'industrie de Douai. L'école répond aux besoins des entreprises locales, régionales et internationales d’embaucher des commerciaux avec de réelles compétences techniques. Elle est actuellement gérée par la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lille[52].
- L’Institution Saint-Jean accueille des classes préparatoires (voie ECS et ECE) depuis 1988, ses résultats lui ont permis de figurer en tête des classements nationaux à plusieurs reprises.
Santé
- Hôpital de Douai construit en 1970 puis reconstruit en 2008.
Vie militaire

Plusieurs unités militaires ayant été en garnison à Douai :
- 27e régiment d'artillerie, 1906.
- 58e régiment d'artillerie.
- 15e régiment d'artillerie de campagne, (avant) 1906 - 1914.
- 41e régiment d'artillerie de campagne, 1914.
- 15e régiment d'artillerie divisionnaire, 1939 - 1940.
- 9e régiment de cuirassiers, 1914.
- 6e régiment de commandement et de soutien, jusqu'à juin 2010.
- Le centre mobilisateur 215 à la caserne Caux est fermé depuis l'an 2000.
Deux unités sont encore présentes à Douai :
- 41e régiment de transmissions, installé en juin 2010.
- État Major de la Brigade de Transmissions et d'Appui au Commandement, depuis juillet 2010.
Médias
Plusieurs journaux ont été publiés à Douai:
- Journal de Douai en 1864 [53]
- La petite Gazette de Douai en 1877[54]
- Douai-sportif à partir de 1925 [55]
- L'Écho de Douai : journal de la propagande républicaine dans l'arrondissement de Douai en 1887 [56]
- L'Observateur du Douaisis
Économie
- Verrerie de Bacquehem fondée en 1788 par Charles-Alexandre-Joseph de Bacquehem qui deviendra verreries Chartier de Prosper Chartier.
- Verrerie Chappuy fondée en 1842.
Grandes entreprises implantées sur la commune
Autrefois siège des Houillères du Nord-Pas-de-Calais (HBNPC), Douai a dû se reconvertir dans les années 1980, notamment avec l'implantation d'une usine Renault et de l'Imprimerie nationale.
- Automobile (Renault Usine Georges-Besse située à Cuincy) : Usine d'assemblage Renault Douai spécialisée dans la production intégrale du Scénic 3, le site a perdu l'assemblage de la Mégane maintenant assemblée en Espagne.
- Métallurgie (emboutissage de pièces automobiles) : activité des anciens Etablissements Arbel devenu Oxford Automotive puis Wagon Automotive usine située boulevard Faidherbes
- Matériel roulant ferroviaire : activité des anciens Etablissements Arbel qui s'appellera Arbel Fauvet Rail après sa fusion avec les établissements Fauvet Girel, depuis 2010, ce qui reste de cette industrie est devenue filiale d'un groupe indien "Titagarh Wagons Limited"
- Imprimerie : l'Imprimerie nationale est installée à Flers-en-Escrebieux depuis 1974.
- Produits chimiques
Douai possède une antenne territoriale de la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lille. Elle gère le port fluvial de Douai.
En septembre 2006, l'implantation d'un centre d'appels téléphonique près de Gayant Expo (duacom - groupe allemand Bertelsmann), employant plus de 300 salariés, permet à Douai de s'ouvrir au monde des services. Cette implantation s'inscrit dans le cadre d'un projet politique engageant le groupe Vivendi (propriétaire de SFR dont est géré une partie du service clients à Douai) à créer 300 emplois dans cette ville moyennant un crédit d'impôts de 2 milliards d'euros (accord conclu entre Vivendi et Nicolas Sarkozy, alors ministre des finances). Nicolas Sarkozy a d'ailleurs visité cette société lors de sa campagne présidentielle en 2007.
Douai centre traverse une grave crise purement locale[57].
Culture et patrimoine
Patrimoine architectural
Douai est classée ville d'art et d'histoire.
Douai conserve des vestiges de son passé militaire, par ses fortifications (porte de Valenciennes, porte d'Arras, tour des Dames), mais aussi son arsenal, sa fonderie de canons, ses casernes.

Le beffroi
Le beffroi de Douai, édifice de 54 m, commencé au XIVe siècle, cache en son clocher un impressionnant carillon de soixante-deux cloches. En 2005, avec vingt-deux autres beffrois du Nord-Pas-de-Calais et de Picardie, (ainsi qu'un en Belgique), le Comité du patrimoine mondial, désigné par l'assemblée générale de l’UNESCO, l'inscrit sur la Liste du patrimoine mondial, au sein du groupe des Beffrois de Belgique et de France. À noter qu'au même moment sont classés au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, les géants de Douai, la famille Gayant.
Le beffroi de Douai a été représenté par Jean-Baptiste-Camille Corot en 1871 dans un tableau qui se trouve actuellement au Musée du Louvre (Voir liste des tableaux de Jean-Baptiste Corot). Victor Hugo a décrit le beffroi, l'a admiré et l'a dessiné.

Les fortifications
L'état général est à découvrir sur le plan relief du XVIIe exposé au musée de la Chartreuse. Seuls quelques vestiges ont échappé au démantèlement des remparts de la ville décidé en 1891.
- La Porte de Valenciennes
Cette porte autrefois appelée porte Notre-Dame a été construite en 1453 en grès. Comme le Palais de Justice, la porte de Valenciennes s'inscrit dans le style gothique pour l'une de ses faces et dans le style classique (XVIe siècle) pour l'autre, très courant à l'époque.
- La Porte d'Arras

Généralement datée du début du XIVe siècle, elle est constituée d'un châtelet à deux tours rondes en grès flanquant le passage d'entrée.
- La Tour des Dames
Tour ronde faisant partie de l'enceinte XIIIe. Elle date de 1425 et est bâtie en grès. Elle se trouve dans un parc du même nom agrémenté d'un plan d'eau.
- Les ouvrages disparus
- La porte Saint-Eloy ou de Paris
- La porte d'Esquerchin ou porte de Béthune
- La porte d'Ocre ou d'Ocq
- La porte de Lille ou porte Morel
- L'ouvrage d'entrée et celui de la sortie des eaux de la Scarpe
Les édifices religieux
Couvent des Franciscains
Lors du creusement d'une tranchée (décaissement de 60 cm) le jeudi , un squelette a été mis au jour Place du Général de Gaulle. Cette découverte corrobore des plans conservées aux archives et les fondations retrouvées du couvent des Franciscains Ordre des frères mineurs détruit à la Révolution. Des centaines d'autres squelettes reposent sous le couvent. Pour ne pas bloquer les travaux du tramway l'ensemble est protégé par un revêtement textile particulier afin de laisser ces vestiges aux générations futures d'archéologues.
Prieuré Saint-Grégoire de Douai
Le temple se situe rue de l’Hippodrome. À la fin du XIXe siècle, l’Église de Douai dépend du pasteur de Valenciennes. Le culte a lieu dans une salle de l’hôtel de ville. Un arrêté préfectoral du 8 août 1897 autorise la construction du temple. Celui-ci est inauguré le 16 mai 1901. Le premier pasteur est Paul Barde en 1906. Ce temple a été rénové à l’occasion de son centenaire en 2001. Au-dessus de la porte, on peut lire : « Ma maison est une maison de prière », ainsi que le verset de Jésus Christ : « Allez et prêchez l’Évangile à toute créature humaine » (Marc XVI, 15).
Bâtiments de Justice
Palais de Justice
Construit à l'emplacement du refuge de l'abbaye de Marchiennes (appelée aussi Grand Constantin) dont il occupe encore certains bâtiments, le palais de justice abrite la cour d'appel de Douai, la cour d'assises du Nord ainsi que le tribunal de grande instance. Refuge de l'abbaye de Marchiennes et, par la suite, siège du Parlement de Flandres (1714), le monument a subi de nombreux remaniements de 1715 à 1790. La façade donnant sur la Scarpe est un héritage de l'art gothique où l'on peut encore admirer les ogives. La cour intérieure date du XVIIIe siècle (néo-classicisme). Le principal témoignage de la naissance de la ville judiciaire est la Grand'Chambre aménagée à partir de 1762.
Hôtel d'Aoust
Situé 50, rue de la Comédie, derrière sa façade de style Louis XV siège depuis 1999 la cour administrative d'appel. La façade sur cour est ornée de statues allégoriques évoquant les quatre saisons[58].
Hôtels particuliers
Hôtel du Dauphin : situé sur la place d'Armes, il est maintenant le siège de l'office de tourisme de Douai, construit en 1754 par l'architecte M. de Montalay[59].
Hôtel Romagnant : situé en face de la Fonderie de canons (Douai), il fut la résidence de Jean-Baltazar Keller, commissaire ordinaire des fontes de l’artillerie de France, qui, nommé par Louvois, choisit le site et créa la fonderie de canon de Douai. Il y vécut du 10 mars 1679 à 1702. L'hôtel doit son nom à un précédent propriétaire, François de Romaignant, autour de 1568[60],[61].
Hôtel de la Tramerie : daté de 1649 au 20, rue des Foulons ancien hôtel de Goy, des seigneurs d'Auby puis de la Tramerie, des seigneurs du Forest et d'Auby[62],[63].
Fonderie de canons
Champ d'aviation de la Brayelle
Monument aux morts
- œuvre de Alexandre Descatoire
Patrimoine environnemental
Parcs et jardins publics
Parc Charles-Bertin
- 1892 : la ville de Douai décide du projet de jardin sur les terrains rendus libres par le démantèlement des fortifications à l'Est de la Place du Barlet.
- Monsieur Pépe, architecte de la ville, et Armand Morlet paysagiste lillois participent au projet.
- : les travaux sont attribués et Victor Bérat, paysagiste, dirige et coordonne les travaux à partir de 1895.
- : réception des travaux.
Le parc porte le nom de Charles Bertin qui fut maire de Douai de 1896 à 1919.
Le parc fait six hectares et est planté de 13 747 arbustes, de 1 176 arbres de 50 espèces dont 27 grands arbres (Ginkgo biloba Pterocarya du Caucase). Un lac est alimenté en eau par forage et pompage alors qu'avant les bombardements de la guerre, l'eau était prélevée directement dans la Scarpe
Parc du Rivage Gayant
L'ancien port charbonnier des HBNPC a été transformé en parc de 21 hectares dont 5 de plan d'eau. Il est ouvert au public depuis l'été 2000. C'est une zone naturelle comportant plus de 7 300 végétaux ainsi que des oiseaux rares.
Parc de la Tour des Dames
C'est un parc paysager établi autour des vestiges des fortifications dont une tour de ronde en grès construite vers 1425. Il est composé d'un plan d'eau de 4 300 m².
Parc Charles-Fenain
Les lieux étaient autrefois occupés par des bénédictins anglais. Le parc fait quinze hectares dont 9 000 m² de plan d'eau. Il comporte plus de 3 000 arbres et arbustes.
Domaine de La Chaumière
70 hectares de forêt pour la protection des eaux souterraines de la vallée de l'Escrebieux.
Réserve naturelle du Marais de Wagnonville
Aquarium
Quai Desbordes
Le quai Desbordes faisant face à l'ancien parlement de Flandres et au palais de justice abrite une belle maison de 1926.
Patrimoine culturel
La Bibliothèque de Douai
La bibliothèque municipale de Douai a été fondée en 1767 par Louis XV. La bibliothèque aux XVIIIe et XIXe siècles était destinée aux chercheurs et aux étudiants. Lors de la Seconde Guerre mondiale, elle a été brulée lors des bombardements. Elle était dans le temps située tout près de la gare. Et après ceci, la bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore a été déplacée en 1955 au 117, rue de la Fonderie.
La réserve patrimoniale est un magasin contenant des manuscrits rares, il existe plusieurs magasins dans la bibliothèque. De nombreux manuscrits anciens sont des confiscations. Les manuscrits douaisiens peuvent être regardées sur Internet, sur le site www.enluminures.culture.fr/. La Bibliothèque accueille aussi des expositions.
Le catalogue des ouvrages (hors manuscrits) est consultable sur le site Internet : https://www.bm-douai.fr
Musée de la Chartreuse
Édifié par Jacques d'Abancourt en style renaissance, pierre et brique, sur l'emplacement de la maison du "Colombier", l'hôtel d'Abancourt (1559) avec sa tour ronde fut agrandi en 1608 par Jean de Montmorency qui construisit en équerre un bâtiment dans le même style avec une tour carrée. Acquis en 1623 par les Prémontés de Furnes, il fut complété lors de l'installation des Chartreux au milieu du XVIIe siècle par la construction de la salle capitulaire et du petit cloître (1663), du réfectoire (1687), du bâtiment dit du prieur (1690), enfin, après le grand cloître et les cellules qui ont été démolis au XIXe siècle, de la chapelle en style jésuite non encore restaurée. Devenue bâtiment militaire à la Révolution, endommagée par les bombardements de 1944, la Chartreuse fut rachetée en 1951 par la ville pour y installer à partir de 1958 le musée des Beaux-Arts dont les bâtiments anciens avaient été détruits par la guerre en même temps que le lycée de garçons dont ils étaient voisins. Ce musée regroupe plusieurs bâtiments datant du XVIIe siècle et XVIIIe siècles. Sur la gauche se trouve l'hôtel d'Abancourt-Montmorency construit entre 1559 et 1608 et de style Renaissance flamande. Construite dans le style classique au début du XVIIIe siècle, l'église des Chartreux se compose d'une vaste nef et de 5 chapelles latérales. Après une campagne de restauration qui aura duré six ans, l'église des Chartreux vous ouvre ses portes pour y découvrir ses collections de sculptures et objets d'art. La nef abrite la collection de sculptures du XIXe siècle. Les cinq chapelles latérales sont consacrées à la présentation des objets d'art dont l'orfèvrerie médiévale, une série de bronzes et de terres cuites de Jean de Bologne, originaire de Douai. Le musée de la Chartreuse organise des expositions temporaires, telle celle de Douai, d'un siècle à l'autre en 1999 qui présenta le plan d'aménagement de la ville de Douai dressé en 1948 par les architectes Alexandre Miniac (1885-1963) et Petit, à l'initiative du secrétariat d'État à la Reconstruction.
Musée des sciences naturelles et d'archéologie
Musée archéologique Arkéos
Théâtre
L'hippodrome de Douai
Ce bâtiment autrefois appelé Cirque Municipal a été entrepris en 1903 sur la place du Barlet lors du démantèlement des fortifications de la ville. L’inauguration du bâtiment pour les fêtes de Gayant en 1904 l’inscrit de fait dans la lignée des lieux symboliques de la culture douaisienne. À partir des années 1970, il prend sa vocation purement artistique avec la création d’une association nommée « Maison de la culture sans murs », rebaptisée Centre d’Animation Culturelle de Douai en 1974. Sa consécration arrivera en 1992, où il prend alors le statut de Scène Nationale.
Le bâtiment est inscrit à l'inventaire des Monuments Historiques en 1981[40].
Conservatoire de musique à rayonnement régional de Douai
Divers
- La borne aux clous est l'objet d'une légende concernant le contrôle de la fidélité des seigneurs de Douai. On y aperçoit des pointes de clous mais aussi une étoile à 6 branches et diverses gravures à la pointe.

Les fêtes de Gayant

Les fêtes de Gayant se déroulent traditionnellement à Douai le premier week-end suivant le 5 juillet, du samedi au lundi. Les fêtes de Gayant correspondent à la sortie annuelle des géants de la ville : Monsieur Gayant, Madame Gayant (aussi connue sous le nom de Marie Cagenon) ainsi que leurs trois enfants Jacquot, Fillon et Binbin. Monsieur Gayant mesure 8,50 m et pèse 370 kg, il est porté par 6 hommes. Marie Cagenon mesure 6,25 m et pèse 250 kg, elle est, elle aussi, portée par 6 hommes. Jacquot mesure dans les 3 mètres et est porté par un homme, Fillon 2,80 m et Binbin 2,20 m. La procession de la famille Gayant est accompagnée d'une fête populaire où se produisent régulièrement des groupes de musique, des fanfares et des artistes de rue. Pour cette occasion, une fête foraine a lieu depuis une centaine d'années sur la place du Barlet. Dans de nombreuses entreprises du Douaisis le lundi, dit «lundi de Gayant», est chômé.
Gayant est un des plus anciens géants puisque son existence remonte à 1530. Les enfants apparaissent au début du XVIIIe siècle. Mais, interdite par l'Église en 1770, la famille ne réapparaîtra qu'en 1801. En 2005, les Gayant acquièrent une reconnaissance mondiale. En effet, l'Unesco a proclamé patrimoine culturel immatériel de l'humanité les Géants et dragons processionnels de Belgique et de France. L'Unesco précise que les processions traditionnelles d'effigies de géants, d'animaux ou de dragons recouvrent un ensemble original de manifestations festives et de représentations rituelles. Apparues à la fin du XIVe siècle dans les processions religieuses de nombreuses villes européennes, ces effigies ont conservé un sens identitaire pour certaines villes de Belgique (Ath, Bruxelles, Termonde, Malines et Mons) et de France (Cassel, Douai, Pézenas et Tarascon) où elles restent des traditions vivantes.
Sports
- Les Francs nageurs cheminots de Douai est une équipe de water-polo évoluant au plus haut niveau du Championnat de France.
- Le Sporting Club de Douai est un club de football d'envergure régionale, mais ayant évolué en Deuxième division après-guerre.
- Le Douai Gayant Futsal évolue en deuxième division nationale pour la saison 2013-2014, après avoir été sacré champion du Nord-Pas-de-Calais.
- Le Douai Hockey Club (hockey sur gazon et en salle) évolue pour la saison 2013-2014 en Élite masculine (les deux sections).
- Le CED, Cercle d'Escrime de Douai, place régulièrement ses jeunes compétiteurs sur les podiums (régional, France et mondiaux).
- Douai possède un tennis club situé sur la frontière entre Lambres-lez-Douai et Douai. Situé Rue de Férin, il possède 4 courts en terre battue, 4 courts sur dur intérieur, 1 court sur moquette et 2 courts sur quick en extérieur.
Personnalités liées à la commune
Gastronomie
Notes et références
Notes
- Par convention dans Wikipédia, le principe a été retenu de n’afficher dans le tableau des recensements et le graphique, pour les populations légales postérieures à 1999, que les populations correspondant à une enquête exhaustive de recensement pour les communes de moins de 10 000 habitants, et que les populations des années 2006, 2011, 2016, etc. pour les communes de plus de 10 000 habitants, ainsi que la dernière population légale publiée par l’Insee pour l'ensemble des communes.
Références
- Source : transferer/dossier de presse.pdf Dossier de presse
- « La fin du tram de Douai » sur France3.fr
- Albert Dauzat et Charles Rostaing, Dictionnaire étymologique des noms de lieu en France, Paris, Librairie Guénégaud, (ISBN 2-85023-076-6), p. 252
- (nl) Maurits Gysseling, Toponymisch Woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland (vóór 1226), Tongres, Belgisch Interuniversitair Centrum voor Neerlandistiek, (lire en ligne).
- Centre de Recherche généalogique Flandre-Artois
- Jean R. Leborgne, Le site et l'évolution urbaine de Douai, Annales de Géographie, n° 314, 1950.
- Michel Rouche, Histoire de Douai, Édition des beffrois, 1985.
- La possibilité d’une intervention des abbayes, nombreuses dans la région (Anchin, Marchiennes etc.), a été évoquée par certains historiens. Les conséquences négatives de ces travaux sur leurs terres agricoles – l’élévation du niveau de l’eau transforma en aval de Douai une bonne partie des prairies et des champs en marais – rendent toutefois cette hypothèse peu probable.
- Dietrich Lohrmann, Entre Arras et Douai : les moulins de la Scarpe au XIe siècle et les détournements de la Satis, Revue du Nord, n° 263, 1984.
- Jean-Pierre Leguay, Les catastrophes au Moyen Âge, Gisserot, 2005, page 31.
- Jacques Godard, Contribution à l'étude de l'histoire du commerce des grains à Douai, du XIVe au XVIIe siècles, Revue du Nord, n° 107, 1944.
- Georges Espinas, la vie urbaine de Douai au Moyen Âge, Picard, 1913.
- Gérard Sivéry, Capitaux et industrie textile au Moyen Âge dans les régions septentrionales, Revue du Nord, n° 275, 1987.
- Habitants réguliers de la ville qui ne répondent pas aux critères de la bourgeoisie, notamment en terme de richesse mobilière et immobilière.
- Individus nouvellement arrivés ou de passage.
- Leguay (2005), op. cit., p. 57-58.
- Félix Brassart, Histoire du château de la châtellenie de Douai, Crépin, 1877.
- Episode célèbre qui sera l'origine de la création des Gayants à Douai.
- Alain Lottin, Lille citadelle de la Contre-Réforme? (1598- 1668), Edition des Beffrois, 1985.
- C'est sur un exemplaire de cette bible que John F. Kennedy a prêté serment lors de son investiture présidentielle
- Des quelques trois cents prêtres envoyés par Douai en Angleterre à la fin du XVI° siècle, plus de cent-soixante furent exécutés tandis que les autres étaient, soit emprisonnés, soit bannis du pays.
- Louis Trenard, De Douai à Lille… Une université et son histoire, Lille III, 1978.
- Dont la devise se retrouve aujourd’hui sur le fronton de l’université de Lille : « Universitas insulensis olim duacencis ».
- Trenard (1978), op. cit.
- Gilbert Dehon, L’Université de Douai dans la tourmente (1635-1765), Presses universitaires du Septentrion, 1998.
- Marie Nikichine, La justice échevinale, la violence et la paix à Douai, thèse de doctorat université Paris I Panthéon- Sorbonne, 2011.
- Martin Barros, Nicole Salat et Thierry Sarmant (préf. Jean Nouvel), Vauban - L’intelligence du territoire, Paris, Éditions Nicolas Chaudun et Service historique de l'armée, , 175 p. (ISBN 2-35039-028-4), p. 166
- Barros et alii, p. 45
- Victor Champier, Le goût français dans les Flandres aux XVIIe et XVIIIe siècles, Revue du Nord, n°60, 1929.
- Paul Parent, L'architecture privée à Douai, du moyen âge au XIXe siècle, Revue du Nord, n°4, 1911.
- Véronique Demars-Sion, Le parlement de Flandre : une institution originale dans le paysage judiciaire français de l’Ancien Régime, Revue du Nord, n°382, 2009.
- V. Demars-Sion, op. cit.
- G. Dehon, Op. Cit.
- Jean Milot, Les garnisons dans les petites villes du Nord à la fin de l'Ancien Régime, Revue du Nord, n° 279, 1988.
- Pdt Wagon, Quelques additions et rectifications à l'étude de M. Victor Champier sur « Le Goût français à Douai », aux XVIIe et XVIIIe siècles, Revue du Nord, n°62, 1930.
- Catherine Denys, Un autre visage de la justice d’Ancien Régime, les juridictions subalternes de Lille et Douai au XVIIIe siècle, in Les justices locales dans les villes et villages du XVe au XIXe siècle, Antoine Follain (dir.) Presses universitaires de Rennes, 2006.
- Rouche, Op. Cit.
- Bernard Lefebvre, Argent et révolution : esquisse d'une étude de la fortune à Douai (1748-1820), Revue du Nord, n° 241, 1979.
- B. Lefebvre, op. cit.
- « L'hippodrome de Douai », notice no PA00107453, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture
- http://www.lobservateurdudouaisis.fr/article/23/08/2013/douai-sous-les-bombes-en-aout-1944--les-bufquin-pere-et-fils-se-souviennent-/4598
- Catalogue de l'exposition "Douai, d'une commune à l'autre, XIIe-XXe siècles" au musée de la Chartreuse (Douai) du 23 janvier au 22 mars 1999, par Jean-Yves Clisant et Vincent Doom.
- Page 42 : Galerie Douaisienne ou Biographie de la Ville de Douai par H. Duthillœul, imprimé par Adam Aubers à Douai en 1884, archivé à la Bibliotheca Bodletana, numérisé par Google Books.
- Page 40 : Galerie Douaisienne ou Biographie de la Ville de Douai par H. Duthillœul, imprimé par Adam Aubers à Douai en 1884, archivé à la Bibliotheca Bodletana, numérisé par Google Books.
- Mélinda Borneman, « Frédéric Chéreau a officiellement pris ses fonctions dimanche 6 avril. Malgré son appartenance politique, le maire de Douai s’inscrit dans la continuité et le respect républicain », L'Observateur du Douaisis, no 587, , p. 6-7
- L'organisation du recensement, sur le site de l'Insee
- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.
- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 20062007 2008 2009 2010 2011201220132014 .
- « Évolution et structure de la population à Douai en 2007 », sur le site de l'Insee (consulté le )
- « Résultats du recensement de la population du Nord en 2007 », sur le site de l'Insee (consulté le )
- IUFM de Douai article de La voix du Nord 26 avril 2010
- Site officiel
- « Le Journal de Douai (Douai) », Europeana (consulté le )
- « La Petite Gazette de Douai », Europeana (consulté le )
- « Douai-sportif : journal hebdomadaire de l'arrondissement de Douai / [imprimeur-gérant M. Goulois] », Europeana (consulté le )
- « L'Écho de Douai : journal de la propagande républicaine dans l'arrondissement de Douai », Europeana (consulté le )
- Crise locale à Douai
- Page 231- Nord Pas-de-Calais Picardie par Sophie Féréet, Martin Balédent, Édition Guide vert Michelin - numérisé par Google Books
- Ephémérides historiques de la ville de Douai, Impr. Deregnaucourt, 1828, Ephémérides historiques de la ville de Douai - Google Livres
- BRASSART Félix, Archiviste et auteur de « l’Histoire du château et de la chastellenie de Douai » 1877 - Crépin éditeur, Douai, 23, rue de la Madeleine - - Chap VI. (page 868 et suivantes de l’original)
- BOUILLET Marie-Nicolas « Balthazar Keller », Dictionnaire universel d’histoire et de géographie, 1878
- Page 475-De Paris à Boulogne, à Saint-Valery, au Tréport, à Calais, à Dunkerque, à Lille, à Valenciennes et à Beauvais par Eugène Penel Publié par Hachette en 1866 - archivé à l'université de Harvard - numérisé par Google Books
- Page 541 Statistique archéologique du département du Nord. Seconde partie-1867-archivé au Harvard College Library numérisé par Google Books
Voir aussi
Articles connexes
- Beffroi de Douai
- Carillon de Douai
- Université de Douai
- Fosses nos 4 - 4 bis et 5 de la Compagnie des mines de l'Escarpelle
- Fosse Bernard de la Compagnie des mines d'Aniche
Bibliographie
- « Bibliothèque douaisienne. Nouveau guide de l'étranger dans Douai... augmenté d'une biographie et d'une bibliographie douaisienne. Orné de vignettes et d'un plan de Douai », Europeana (consulté le )
- Dechristé, Louis, « Souv'nirs d'un homme d'Douai de l'paroisse des Wios Saint-Albin, aveuc des bellés z'images. Tome 2 / . Croquis historique en patois douaisien, par L. D. », Europeana (consulté le )
- Guy-Gosselin, L'Âge d'or de la vie musicale à Douai. 1800-1850. Liège, [1994]
- Les Beffrois de Belgique et de France inscrits au Patrimoine Mondial de l'Humanité de l'Unesco ; Éditions J. et L. Denière (ISBN 978-2-911327-26-1)