Bob Dylan
| Surnom |
Elston Gunnn[1], Blind Boy Grunt[2], Zimbo[3], Zimmy[4], Lucky Wilbury, Boo Wilbury, Elmer Johnson, Sergei Petrov[5], Jack Frost[6], Jack Fate, Willow Scarlet, Bob Landy[2], Robert Milkwood Thomas[2] Tedham Porterhouse |
|---|---|
| Nom de naissance | Robert Allen Zimmerman |
| Naissance |
Duluth (État du Minnesota - États-Unis) |
| Activité principale | Auteur-compositeur-interprète, musicien, peintre et poète |
| Genre musical | folk, folk rock, rock, blues, blues rock, art rock, country et country rock |
| Instruments | Guitare, harmonica, basse et piano |
| Années actives | Depuis 1959 |
| Labels | Columbia |
| Site officiel | bobdylan.com |

coucou je suit un viruse pour vous prevenire que tu va mourire ta more sera dans 4 joure
Il participe au concert pour le Bangladesh organisé par George Harrison, en août 1971, à New York. Premier concert de charité de l'histoire de la musique populaire, un disque et un film en seront tirés.
En 1973 il interprète le rôle du reporter Alias dans Pat Garrett et Billy the Kid, western de Sam Peckinpah avec Kris Kristofferson (une prestation cinématographique très attendue, mais au ironiquement quasi-muette — bien que cruciale dans le récit). Il en écrit la musique[7] : en grande partie instrumentale, cette bande originale contient le tube Knockin' on Heaven's Door. Son ami Roger McGuinn (des Byrds) y participe activement et le disque sort la même année, rencontrant un franc succès.
Ce n’est qu'en 1974, après la parution de Planet Waves, un album enregistré avec The Band, que Dylan décide de repartir en tournée[8].
Il chante de manière plus agressive que jamais : il mord et crache les mots, joue sur leur sonorité, crie, la voix flexible, vigoureuse, sauvage et emportée[9]. La tournée, illustrée par l'album live Before the Flood, est suivie par la sortie d'un nouvel album, Blood on the Tracks, où Dylan évoque son divorce avec Sara Lownds-Dylan (clairement évoqué dans Desire)[10]. Les chansons explorent toutes les facettes de la détresse amoureuse : l’apitoiement sur soi-même, la colère, les rechutes amoureuses, etc. Tout cela dans un style poétique proche de son « âge d'or » du milieu des années 1960, et avec un tout nouveau son, synthèse entre l’ancien et le nouveau : acoustique habillée de batteries, de basses et de claviers. Le disque remporte un grand succès, qui ne suffit pas à sortir Dylan de sa dépression, mais ne lui enlève pas non plus le sens de la répartie : à une journaliste qui lui confie son enthousiasme, il rétorque qu’il ne voit vraiment pas comment on peut aimer éprouver des sentiments tels que ceux exprimés par Blood on the Tracks[11].

À l'automne de l'année suivante, le chanteur réunit ses vieux amis, parmi lesquels la chanteuse folk Joan Baez, les guitaristes Roger McGuinn et Mick Ronson, et entame une tournée qui se veut épique et bohème, dans un esprit hippie déjà un peu dépassé à l’époque : la Rolling Thunder Revue[12]. La caravane, forte de dizaines de fêtards et de musiciens, fait escale dans de petites salles, joue avec des musiciens de bar recrutés sur place, et un film est tourné Renaldo et Clara[13]. Toutefois, durant la seconde moitié de la tournée, au printemps 1976, l'enthousiasme a laissé place à une lassitude qui transparaît sur l'album Hard Rain, enregistré et paru en 1976. Il faudra attendre près de 30 ans pour qu'un témoignage live des concerts de l'automne 1975 soit publié, dans le cadre des Bootleg Series[14].
Entre les deux segments de la tournée, Dylan sort l'album Desire, résultat d'une collaboration avec le parolier Jacques Levy. Cette idée aboutit à des récits nimbés de mystère pleins de pyramides, de gangsters et de voyous, habillés par une orchestration très riche où le violon, tenu par Scarlet Rivera, musicienne rencontrée par hasard pendant la tournée, occupe une grande place. On y trouve également pour la première fois depuis plus de dix ans un chant de protestation : Hurricane, qui raconte le procès du boxeur Hurricane Carter emprisonné pour meurtre[15], et que Dylan est alors résolu à faire libérer.
L'année 1977 sera principalement consacrée au montage de Renaldo et Clara, qui sera mal compris par les critiques et le public. Après un premier montage d'une durée de quatre heures, Dylan le remonte, coupe, édite, pour aboutir à une version de deux heures. Il entreprend une nouvelle tournée mondiale au Japon avec une série de concerts qui feront l'objet du double album Live at Budokan, réservé dans un premier temps exclusivement au marché japonais, avant que Columbia ne décide de le sortir mondialement. Au retour de sa tournée et avant de repartir pour sa première tournée européenne depuis 1966, Dylan enregistre en une quinzaine de jours, dans son propre studio Rundown Studios de Santa Monica, un nouvel album, Street-Legal, lequel est publié en .
Période chrétienne (1979–1981)
En 1979, Dylan se convertit au christianisme et se met à écrire sobrement à propos de spiritualité, évoquant aussi sa relation avec Dieu[a 1]. Si le premier disque de cette période, Slow Train Coming, avec notamment Mark Knopfler à la guitare et Tim Drummond à la basse, se révèle remarquablement singulier et novateur dans son œuvre, les suivants sont plus traditionnels : les textes et les arrangements sont souvent inspirés du gospel, comme pour un retour aux sources, aux « roots » de cette musique qu'il a contribué à révolutionner. La production y est soignée, habillant notamment sa musique de chœurs et de cuivres, fervents, dans Saved, et Shot of Love. Dans ce dernier opus il rend hommage à Lenny Bruce (humoriste et activiste notoire aux États-Unis, inventeur du stand-up). On y retrouve un membre des Beatles (Ringo Starr), et un membre des Rolling Stones (Ron Wood).
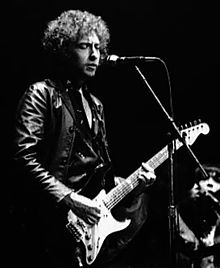
Ces albums, une fois de plus discutés par les critiques[réf. souhaitée], contiennent quelques perles comme Man Gave Names to All the Animals (premier morceau reggae de son répertoire, et immense succès commercial), ou Every Grain of Sand. Un tel souffle épique parcourt cette trilogie pleine de ferveur[non neutre] (démonstration vocale, « profession de foi » musicale quelle que soit la croyance intime adoptée parmi les divers cultes chrétiens), qu'elle perturbera par exemple un journaliste de Gala, qui dira que Slow Train Coming « est un petit bijou inspiré » et que « Saved et Shot of Love sont plus proches d’une extase habitée : litanies ecclésiastiques et textes liturgiques étouffés par les chœurs et des cuivres assourdissants. »[16]. Les paroles donnent des signes avant-coureurs des grands concerts de charité du milieu des années 80, le Live Aid et le Farm Aid auxquels il participera[17].
Le fait que Dylan soit ostensiblement devenu chrétien l'a éloigné de plusieurs disciples et collègues[18]. Peu de temps avant son assassinat, John Lennon enregistre Serve Yourself (sv) en réponse à la chanson Gotta Serve Somebody (en)[19] (ce titre a valu à Dylan un Grammy Award comme « Best Male Rock Vocal Performance » en 1979[20] ; ce qui n'est pas sans surprendre ceux qui ont toujours raillé sa diction[Interprétation personnelle ?]).
En 1981, quand la foi de Dylan est révélée à l'opinion publique et abondamment commentée, Stephen Holden écrit dans le New York Times que « ni son âge (il a 40 ans), ni sa conversion au christianisme très médiatisée n'ont modifié son tempérament essentiellement iconoclaste »[21].
Années 1980
En 1983, Dylan met fin à sa période « born-again » et enchaîne avec Infidels, dont les thèmes tournent autour de la spiritualité de manière plus nuancée que dans la trilogie précédente, incluant les sentiments amoureux, la sémantique rastafari (comme dans le titre I & I), le judaïsme[citation nécessaire], et quelques reflexions sociétales (comme dans Union Sundown). Il aborde de nouveau des thématiques plus concernées par l'actualité que par l'éternité. De son propre aveu[22], le chanteur a perdu quelque chose de son « feu sacré » : les chansons ne viennent plus avec la même facilité qu’avant, et son enthousiasme s'est érodé[réf. souhaitée]. Toutefois, selon Michael Gray[23][source insuffisante], les sessions pour cet album, produit à nouveau par Knopfler, ont abouti à plusieurs chansons notables que Dylan a laissées de côté par manque de jugement, et qui seront en partie diffusées via le bootleg de 1983 Rough Cuts, et publiées plus tard officiellement dans la compilation d'inédits Bootleg Series 1-3 Rare & Unreleased 1961-1991)[24].
En 1987, il s'associe avec le Grateful Dead pour une série de concerts[25] : un album intitulé Dylan and the Dead regroupe un florilège des nombreux morceaux joués en commun, et le Grateful Dead inclut systématiquement par la suite plusieurs morceaux de Bob Dylan lors de chacun de ses concerts proposant ainsi sa propre lecture de ces morceaux[réf. souhaitée]. Sur les conseils de Bono, le chanteur de U2, il enregistre ensuite avec le producteur Daniel Lanois l'album Oh Mercy[26],[27]. En 1988 et 1989, il fait partie du super groupe éphémère les Traveling Wilburys pour deux albums, regroupant, sous des pseudonymes, outre Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne, Tom Petty et Roy Orbison[28].
Reprises folk et blues (1992–1995)

Alors que sa maison de disques commence à éditer des coffrets regroupant ses archives, Dylan entame la décennie 1990 avec les albums Good as I Been to You et World Gone Wrong, entièrement composés de reprises de vieux titres folk et blues[27]. On peut donc penser[Interprétation personnelle ?], au vu de la qualité de ce qu'a composé Bob Dylan par la suite, qu'il s'agit pour lui d'un nouveau départ[réf. nécessaire].
Renaissance sans fin (1997–2009)

Depuis la fin des années 1980, Dylan enchaîne les concerts sur les cinq continents. Ce « Never Ending Tour (en) » (une appellation désapprouvée par Dylan) est l’occasion pour lui de revisiter ses standards en laissant la part belle à l’improvisation[réf. souhaitée] : son groupe change de set-list tous les soirs, et ne rejoue quasiment jamais une chanson de la même façon d’un soir sur l’autre[réf. souhaitée].
En 1997, Dylan s’associe à nouveau avec Daniel Lanois pour enregistrer Time Out of Mind, son premier album de compositions originales depuis sept ans. Jalonné de compositions habitées[réf. nécessaire], Time Out of Mind est une chronique désespérée mais bien vivante de la vieillesse d’une vedette du rock. Dylan y pose un regard sans complaisance sur son âge[réf. souhaitée], évitant au passage les clichés rock and roll.
En 2000, il obtient le prix Polar Music.
En sort Love and Theft. Très bluesy et jazzy, dépouillé et proche du son de ses concerts, ce nouvel album est nettement plus enthousiaste que ses précédents. Ce n'est que cinq ans plus tard, en août 2006, que sort son successeur, Modern Times, dont le titre fait référence au film homonyme de Charlie Chaplin. Modern Times est généralement considéré comme le troisième volet d'une trilogie commencée avec Time Out of Mind, bien que Dylan lui-même considère que, si trilogie il doit y avoir, elle s'ouvre plutôt sur Love and Theft. Produit par Dylan et enregistré dans des conditions quasi live avec le groupe qui l'accompagne sur scène, Modern Times retrouve les accents de jazz, de ragtime, de bluegrass et de rockabilly de Love and Theft, dans une ambiance plus feutrée et glamour, qui fait référence à l'âge d'or des années 1930 : celle des postes à galène, de Bing Crosby et de Louis Armstrong. Pour accompagner la sortie de cet album, Dylan déclare dans le magazine Rolling Stone que rien de ce qui a été fait depuis les vingt dernières années n'a grâce à ses yeux[réf. souhaitée].

D’autre part, alors que Martin Scorsese lui consacre le film documentaire No Direction Home, Dylan finalise la rédaction de la première partie de ses mémoires, Chroniques, Volume 1. Ce livre présente sa vision personnelle sur des périodes mal connues de sa vie, comme ses débuts à New York, ou l’enregistrement de Oh Mercy en 1989. La parution régulière des Bootleg Series, enregistrements jadis uniquement disponibles sous forme de disques pirates (bootlegs en anglais) de piètre qualité, désormais remasterisés et publiés officiellement, lève le voile sur des prestations légendaires audibles pour la première fois par le grand public[réf. souhaitée]. (Le huitième volume de cette série, Tell Tale Signs: Rare and Unreleased 1989-2006, est sorti en .)
En sort la compilation Dylan 07, ainsi que le remix inclus de Most Likely You Go Your Way and I'll Go Mine par le DJ Mark Ronson. En décembre de la même année, le film de Todd Haynes I'm Not There s'inspire « des nombreuses vies » et chansons de Bob Dylan, qui y est interprété par six acteurs et une actrice. Dylan obtient le prix Pulitzer de musique en avril 2008, « pour son profond impact sur la musique populaire et la culture américaine, à travers des compositions lyriques au pouvoir poétique extraordinaire », selon le jury[29]. Fin , Dylan sort son trente-troisième album : Together Through Life, issu d'une collaboration avec Robert Hunter, parolier du Grateful Dead. En octobre de la même année paraît Christmas in the Heart, un album de reprises de chants de Noël dont les bénéfices sont intégralement reversés à diverses œuvres caritatives.
Années 2010
Une tournée européenne a lieu fin 2011 avec Mark Knopfler, avec qui il a enregistré Slow Train Coming. En mars 2012, le musicien et chanteur David Hidalgo, du groupe de rock mexicain Los Lobos (qui a déjà travaillé sur Together Through Life et Christmas in the Heart), annonce que Dylan travaille sur un nouvel album studio aux consonances mexicaines, dans les studios de Jackson Browne, à Los Angeles. L'album intitulé Tempest sort le [30]. Tempest est largement défendu sur scène au cours des concerts du « Never Ending Tour » de 2013 et 2014 : six titres de Tempest constituent désormais presque systématiquement l'ossature des setlists du groupe[réf. souhaitée].
Fin 2014, en rappel de presque toutes ses dates américaines, Dylan reprend le standard Stay With Me de Frank Sinatra. C'est un aperçu de ce qui constituera son prochain album[réf. nécessaire]. C'est un Dylan extrêmement appliqué qui livre ces performances, certaines lui valant même, lors des dates finales de la tournée au Beacon Theater de New York, une ovation de plusieurs minutes[réf. souhaitée]. Un article de Rolling Stone souligne alors avec enthousiasme le retour d'une forme d'implication certaine dans les performances vocales du songwriter qui assure désormais un spectacle efficace et rodé[réf. souhaitée].
Shadows in the Night, le trente sixième album studio de Bob Dylan, sort en février 2015. L'accueil critique de cet album de reprises est extrêmement positif ; la presse internationale salue la qualité d'interprétation de ces standards, enregistrés en condition live, et la performance habitée de Dylan[réf. souhaitée]. En France, le mensuel Les Inrocks qualifie ainsi Shadows in the Night : « […] Un album de ballades éternelles, dont la grâce incontestable doit beaucoup à ses musiciens. […] Dylan n’a plus qu’à y poser sa voix, du coup adoucie et languide, de moins en moins astringente. » Y figure la reprise de Autumn Leaves, adaptation par Frank Sinatra du standard d'Yves Montand Les feuilles mortes. Dans la foulée, le « Never Ending Tour » reprend, les setlists incluant en général deux extraits de Shadows in the Night en milieu et fin de concert.
Le , le single The Night We Called It a Day se voit doté d'un clip, réalisé par Nash Edgerton. La vidéo, présentée en noir et blanc, reprend avec ironie les procédés visuels de grands films noirs. Dylan y interprète un gangster. Le , à l'occasion de son ultime présentation du célèbre Late Show, David Letterman invite Bob Dylan. C'est la première apparition télévisée de ce dernier depuis 1984, au sein de cette même émission. L'artiste y interprète The Night We Called It a Day, après avoir été présenté par Letterman comme « le plus grand chanteur et songwriter de l'époque moderne »[réf. souhaitée].
Le , à la surprise générale, le prix Nobel de littérature est attribué à Bob Dylan « pour avoir créé de nouvelles expressions poétiques »[31]. Au journal britannique The Telegraph, il a confessé en être très étonné. « C'est dur à croire ! », a-t-il déclaré, brisant deux semaines de silence de manière assez lapidaire[32]. Il est le premier poète musicien à être récompensé par l'académie depuis la création du prix en 1901[33]. Mais le chanteur, toujours aussi réfractaire au star-system, tout en acceptant cette attribution, s'en est tenu à l'écart : « Ce qui a le don d'agacer un membre éminent de l'Académie suédoise, qui a fustigé un comportement « arrogant » de la part de l'Américain »[34]. La secrétaire de l'Académie a déclaré[35] avoir renoncé à le joindre. « À l'heure actuelle, nous ne faisons rien. J'ai appelé et envoyé des courriers électroniques à son collaborateur le plus proche. » Elle reconnaissait avoir obtenu « des réponses très aimables », qui comblaient ce silence dans lequel s'était réfugié l'auteur ; avant qu'il annonce qu'il ne participerait pas à la cérémonie de remise des prix, car « malheureusement il avait d'autres engagements »[32]. C'est finalement sa consœur Patti Smith qui s'est arrangée avec lui pour venir chercher la médaille le jour J. La poétesse a lu un message sincère du récompensé, avant d'interpréter avec émotion It's a Hard Rain That Gonna Fall devant l'honorable assemblée, et d'être chaleureusement applaudie[36]. « J'ai choisi A Hard Rain's A-Gonna Fall parce que c'est l'un de ses plus beaux morceaux. À sa maîtrise très rimbaldienne de la langue américaine, elle mêle une profonde compréhension des causes de la souffrance humaine, et au final de sa résilience », avait écrit en préambule Patti Smith sur sa page Facebook.
Il enregistre son discours d’acceptation du prix Nobel le À Los Angeles[37].
Années 2020
Le , Dylan annonce la sortie de son 39e album studio, Rough and Rowdy Ways, pour le . Il s'agit de son premier album de chansons originales depuis Tempest en 2012[38],[39],[40].
Trois titres ont été révélés au public en amont de la sortie de l'album : Murder Most Foul le 27 mars, I Contain Multitudes le 17 avril, et False Prophet le 8 mai. Le premier single, Murder Most Foul, long de 17 minutes, se réfère à l'assassinat du président Kennedy en 1963. En décembre 2020, le groupe Universal Music rachète l’intégralité du catalogue de Bob Dylan ; il cède certains des morceaux les plus célèbres comme Blowin in the Wind, ou encore Like a Rolling Stone. Selon le New York Times, la transaction pourrait dépasser les trois cents millions de dollars.[41]
Distinctions
- 1990 :
 Commandeur de l'ordre des Arts et des Lettres
Commandeur de l'ordre des Arts et des Lettres - 1998 : Grammy Award de l'album de l'année pour Time Out of Mind
- 2000 : Oscar de la meilleure chanson originale pour Things Have Changed, chanson tirée du film Wonder Boys
- 2013 :
 Officier de la Légion d'honneur[42]
Officier de la Légion d'honneur[42] - 2016 : Prix Nobel de littérature
- En juin 2017, l'astéroïde de la ceinture principale (337044) Bobdylan est nommé en son honneur.
Analyses
Passages au Festival Folk de Newport
Le , le retour de Bob Dylan au festival de folk de Newport fut l’occasion de s’interroger sur la rupture présumée entre lui et son public en 1965. La forte conspuation perceptible sur les bandes n’est pas anecdotique : elle ponctuera en effet les tournées américaines et européennes qui suivront, dès lors que Dylan est rejoint par son groupe.
Révélée quatre ans plus tôt à ce même festival, Joan Baez est la tête d’affiche de l'édition 1963 et y introduit Dylan (chemise militaire kaki et blue-jeans délavés), précédé par sa renommée grandissante de chanteur protestataire. Après son tour de chant, il rejoint sur scène Peter, Paul and Mary, Joan Baez, Pete Seeger et The Freedom Singers, et la fête s’achève en chœur sur We shall Overcome. Le dimanche soir, Baez, qui chante With God on our side l’invite à la rejoindre sur scène et le festival se conclut sur le triomphe de Dylan, alors en communion totale avec son public[43].
En 1964, Dylan, par ses chansons, les concerts qu'il donne, est une célébrité du monde folk[44], tandis que les topical songs que composent des artistes tels que Phil Ochs, Tom Paxton ou Buffy Sainte-Marie sont très populaires[43]. Dylan, qui fait trois apparitions cette année-là, chante cependant des chansons plus personnelles de l'album à paraître Another Side, telles que All I Really Want to Do, It Ain't Me Babe et To Ramona, ainsi que Mr. Tambourine Man qui figurera sur Bringing It All Back Home. Ses premiers fans le ressentent déjà comme une trahison : Irwin Silber, alors rédacteur en chef du magazine folk Sing Out!, rédigea ainsi en novembre 1964 « une lettre ouverte à Dylan » dans laquelle il manifeste son inquiétude à propos du « détachement », du « potentiel d'auto-destruction » de Dylan et de ses nouvelles chansons « centrées sur lui-même, sentimentales et cyniques »[45] ; tandis que Paul Wolfe, un auteur de Broadside, décrivit Dylan comme « un faussaire, un hypocrite et un manipulateur de son public »[43].
Le , Dylan est la tête d’affiche du festival mais, à l’image de sa tenue vestimentaire (lunettes de soleil Wayfarer et blouson de cuir), les choses ont changé. Pour lui d’abord : en mars est paru Bringing It All Back Home, composé pour moitié de morceaux acoustiques et pour moitié de morceaux à l'instrumentation rock. Puis le 20 juillet soit quelques jours seulement avant le festival est sortie Like a Rolling Stone, chanson radicalement novatrice, qu’il compte jouer au festival. Sur les ondes d’autre part : alors que les Beatles monopolisent le Top Ten, la reprise pop de Mr. Tambourine Man par les Byrds marque les esprits. Au Royaume-Uni, parallèlement à la Beatlemania, le rock renaît grâce à la redécouverte du blues (c'est d'ailleurs le sens du titre « Bringing it all back home » — soit « Ramenons tout ça à la maison »).
À l’atelier blues de ce festival est également présent le Paul Butterfield Blues Band, un groupe de blues urbain, avec guitares électriques et amplificateurs, qui connait le succès avec le titre Born In Chicago, tiré de leur premier album The Paul Butterfield Blues Band. Outre le chanteur Paul Butterfield, le groupe se compose du guitariste Mike Bloomfield, du bassiste Jerome Arnold et du batteur Sam Lay. Renforcés par le pianiste Barry Goldberg et l’organiste Al Kooper, Dylan et les musiciens du Paul Butterfield Blues Band répètent toute la nuit un nombre limité de chansons : Maggie’s Farm, Like a Rolling Stone et Phantom Engineer[46]. Le lendemain, ils jouent ces trois morceaux, et les transitions entre chaque sont accompagnées d’un brouhaha indescriptible[47]. Sur la demande du présentateur Peter Yarrow, de Peter, Paul And Mary, Dylan revient accompagné d’une guitare acoustique et interprète seul deux de ses succès passés : It’s All Over Now Baby Blue et Mr. Tambourine Man[48].
De cet événement, relaté par Robert Shelton, naquit la légende de Dylan délaissant le folk pour le rock, indifférent à l’indignation et à l’amertume de son public[49], tandis qu’en coulisse, les bruits les plus fous circulaient (la rumeur prétendit que le chanteur Pete Seeger, furieux, était allé chercher une hache pour couper les câbles du micro, ce qu’il démentit[48], de même que l'organisateur[50]). Cependant, des arguments viennent contredire cette interprétation, notamment ceux avancés par Bruce Jackson, un des organisateurs du festival, qui a étudié de près les enregistrements qu’il avait conservés[48]. Jackson argue tout d’abord que la première personne sifflée ne fut pas Dylan, mais Peter Yarrow, chargé de l'annoncer et dont les phrases entrecoupées par de longs silences agaçaient un public impatient. D’autre part, les applaudissements sont nourris quand Dylan apparaît, alors que les instruments électriques sont déjà installés et visibles sur la scène. Par ailleurs, quand le groupe joue, la voix de Dylan est noyée sous le volume de l’instrumentation, en raison d’une balance sonore trop hâtive. Jackson avance également que, bien que Dylan soit la tête d’affiche du festival, il ne joue que quinze minutes, alors que d’autres sont restés sur scène 45 minutes ; une partie du public aurait donc réagi à ce passage trop court[48]. Mais il n'en reste pas moins que ce passage si bref constitue, pour plusieurs historiens, la bataille d'Hernani de la musique populaire, et l'irruption sur la scène musicale de la contre-culture des années 1960. En mariant la puissance du rock à l'introspection du poète, Bob Dylan ouvre la voie à une nouvelle vague d'auteurs-compositeurs : Jim Morrison, Neil Young, Leonard Cohen, Lou Reed, Bruce Springsteen, Patti Smith, Laura Nyro, tout en ayant une influence considérable sur les Beatles et bien d'autres, à partir du milieu des années 1960 et durant les décennies suivantes[48].
Influence sur son époque
Le festival de Newport de 1965, mais aussi l’album Highway 61 Revisited, la tournée européenne de 1966, et les sessions musicales dans une bâtisse de Woodstock (Big Pink) en août 1967, ont marqué durablement l’histoire de la musique américaine. De cette « année où Bob Dylan a disjoncté »[51], vécue par une partie de son public comme une rupture, voire une trahison, est sortie une musique qui s'est révélée, avec le recul, une des premières synthèses de la country, du folk, du blues, du rock et de la soul. Bob Dylan, avec le groupe The Band, a contribué à faire rentrer la musique populaire américaine dans l'ère moderne[52].
Dès ses débuts en 1961, Dylan fait également parler de lui dans les milieux folk aux États-Unis en adoptant une manière de chanter très expressive, loin des standards de la chanson. Dylan a en réalité recherché davantage l'expressivité que la beauté classique. Il a considérablement expérimenté l'usage des dissonances, se faisant ainsi l’héritier direct des bluesmen des années 1930, tel Howlin' Wolf. Il a joué de sa voix et l’a fait évoluer, tout en lui gardant un timbre si particulier[e 1],[53].
Mais un autre domaine dans lequel Dylan a frappé les esprits est celui des textes : dès son deuxième album (le premier étant presque entièrement composé de reprises, comme cela se pratiquait très couramment à l’époque), il a incarné une nouvelle manière d’envisager l'écriture de chansons. Inspirés par la littérature, la poésie symboliste et surréaliste, mais aussi les « folksongs » réalistes de la grande tradition américaine, ses textes dessinent un univers intérieur d’une grande richesse. Dès le début, le thème principal de l’œuvre de Dylan est son expérience personnelle du monde, sa vision des choses, qu’elle soit réelle ou fantasmée. Le surréalisme et les images qui imprègnent la plupart de ses textes, même les plus simples, atteignent leur sommet en 1965 et 1966 lorsque Dylan délaisse le folk pour le rock 'n' roll. Les textes de cette époque ne cherchent pas à avoir un sens figé, mais à décrire des impressions et des sentiments au-delà des mots. Comme un tableau abstrait, ils peuvent acquérir un sens différent selon l’humeur de l’auditeur, tout en conservant une très forte identité. En cela, les mots de Dylan s’approchent de l’essence même de la musique, qui tire une partie de son pouvoir du fait qu’elle est le seul art à n’être aucunement figuratif, à une époque où la plupart des chansons populaires, et particulièrement les chansons rock, parlaient encore des (més)aventures sentimentales de leurs auteurs et de voitures. Elles ont considérablement influencé l'ensemble des artistes pop de l’époque, y compris les Beatles[54], qui ont à leur tour contribué à révolutionner l'esthétique pop, en y insufflant une ambition artistique jusqu'alors insoupçonnée.
Enfin, par son attitude de méfiance voire de défiance envers son statut de vedette, Dylan a remis en cause certaines conceptions du rôle des artistes dans la société. Adulé par le public folk et les milieux contestataires du début des années 1960, il refusa d’assumer ce rôle de musicien engagé, préférant inciter ses admirateurs à rejeter toute tutelle, comme il l’exprime dans certains de ses textes (« Don't follow leaders / Watch the parkin' meters » — « Ne suis pas les meneurs / Observe les parcmètres », dès 1965)[55], à penser par eux-mêmes et à renoncer aux « prophètes » (auto-proclamés), de quelque bord qu’ils soient. Il a fui également toute position d'idole du public, rock ou autre. Il a refusé de se faire enfermer dans son passé, de se laisser muséifier[56].
Vie privée
Le , Dylan se marie à Wilmington, avec Sara Lownds, mannequin (née Shirley Marlin Noznisky le dans le Delaware). Ce mariage reste secret jusqu'en , quand paraît dans le New York Post un article de la journaliste Nora Ephron intitulé « Hush! Bob Dylan is wed ». Leur premier enfant, Jesse Dylan, naît le . Ils ont trois autres enfants : Anna Leigh (née le ), Samuel Isaac Abraham (né le ), et Jakob Luke Dylan (né le à New York)[57]. Dylan a également adopté la fille de Sara d'un mariage antérieur, Maria Lownds (devenue Maria Dylan, née le ). Celle-ci est actuellement[Quand ?] mariée au musicien Peter Himmelman (en). Depuis 1989 son fils Jakob est le chanteur principal et le parolier du groupe de rock de Los Angeles The Wallflowers. Jesse Dylan est un réalisateur et un homme d'affaires prospère. Samuel Isaac Abraham Dylan est devenu photographe. Bob Dylan et Sara divorcent le [58].
Bob Dylan a un cinquième enfant, Désirée Gabrielle (née le à Los Angeles)[57], de sa seconde épouse, la choriste Carolyn Dennis (en)[59] qu'il épouse le [60] ; ils divorcent en [a 2],[61].
Il aurait une autre fille prénommée Narette[57], née d'une relation avec Clydie King (née Clydie May Crittendon[62] le à Dallas au Texas). Clydie King fut la choriste de Bob Dylan pour Saved en 1980, Shot of Love en 1981, Infidels en 1983.
Discographie sélective
- 1962 : Bob Dylan
- 1963 : The Freewheelin' Bob Dylan (*)
- 1964 :
- 1965 :
- 1966 : Blonde on Blonde (*)
- 1967 : John Wesley Harding (*)
- 1969 : Nashville Skyline (*)
- 1970 :
- 1973 :
- 1974 : Planet Waves (*)
- 1975 :
- 1976 : Desire (*)
- 1978 : Street-Legal (*)
- 1979 : Slow Train Coming (*)
- 1980 : Saved
- 1981 : Shot of Love
- 1983 : Infidels (*)
- 1985 : Empire Burlesque
- 1986 : Knocked Out Loaded
- 1988 : Down in the Groove
- 1989 : Oh Mercy (*)
- 1990 : Under the Red Sky
- 1992 : Good as I Been to You
- 1993 : World Gone Wrong
- 1997 : Time Out of Mind
- 2001 : Love and Theft (*)
- 2006 : Modern Times
- 2009 :
- 2012 : Tempest
- 2015 : Shadows in the Night
- 2016 : Fallen Angels
- 2017 : Triplicate
- 2020 : Rough and Rowdy Ways (sortie prévue le 19 juin)
(*) Albums ayant été remasterisés et réédités en version Super Audio CD.
Composition du groupe de scène depuis 2007
En 2007, le groupe de scène de Bob Dylan réunit les musiciens suivants[63] :
- Bob Dylan : voix, guitare, claviers, harmonica ;
- Stu Kimball : guitare rythmique ;
- Denny Freeman (en) : guitare lead (2007-2010) ;
- Charlie Sexton : guitare lead (depuis 2010) ;
- Donny Herron : guitare pedal steel, guitare lap steel, mandoline électrique, banjo, violon ;
- Tony Garnier : basse, contrebasse ;
- George Recile : batterie ;
- Tommy Morrongiello : guitare rythmique (occasionnellement), technicien guitare.
Filmographie
Longs-métrages
- 1973 : Pat Garrett et Billy le Kid, de Sam Peckinpah : Alias
- 1978 : Renaldo et Clara, de Bob Dylan : Renaldo
- 2003 : Masked and Anonymous, de Larry Charles : Jack Fate (également co-scénariste)
Documentaires
- 1967 : Festival, de Murray Lerner
- 1972 : Dont Look Back, de D.A. Pennebaker
- 1972 : George Harrison and Friends : The Concert for Bangladesh, de Saul Swimmer
- 1973 : Eat The Document, de D.A. Pennebaker
- 1978 : La Dernière Valse, de Martin Scorsese (dernier concert du groupe The Band, avec une pléiade d'invités prestigieux, dont Bob Dylan, Neil Young, Muddy Waters, Johnny Winter...)
- 1990 : Hearts of Fire, de Richard Marquand
- 2005 : No Direction Home, de Martin Scorsese
- 2007 : The Other Side of the Mirror: Bob Dylan Live at the Newport Folk Festival 1963–1965, de Murray Lerner
- 2019 : The Rolling Thunder Revue (en), de Martin Scorsese
Autres
- 2007 : I'm Not There de Todd Haynes, un film sur la vie de Bob Dylan, dans lequel l'artiste est successivement interprété par six acteurs et une actrice
- En 2008, il compose une chanson pour le film My Own Love Song d'Olivier Dahan.
Peinture

Bob Dylan est aussi peintre. Il commence à peindre en 1974, sous la direction du peintre Norman Raeben. Ses toiles les plus connues ont été peintes lors de périples successifs au Brésil, dont il donne une vision toute personnelle. Sans tomber dans la dénonciation sociale, il peint des figures originales de la société brésilienne, remarquables par leurs aspects démodés (tenues traditionnelles, danses folkloriques…), à rebours des canons contemporains de la mode et de la beauté. Il cherche avant tout à donner une image la plus vivante possible, et surtout la plus matérielle, comme pour le plat de pâtes mangé par le couple du tableau The eaters[64].
D'autres peintures, reprenant des croquis réalisés sur la route entre 1989 et 1992, ont été exposées en 2007 et 2014[65].
Expositions de ses peintures :
- 2010 : La peinture de Bob Dylan, L'intermède.com The Brazil Series, Statens Museum for Kunst (Copenhague)[66],[67], jusqu'au 30 janvier 2011.
- 2014 : Drawn Blank Series[65]
Notes et références
Références par ouvrage
- (en) Howard Sounes, Down the Highway : The Life of Bob Dylan, Black Swan, , 624 p. (ISBN 978-0-552-99929-8).

- p. 323-337.
- p. 372-373.
- (en) Anthony Scaduto, Bob Dylan, Helter Skelter Publishing, , 5e éd. (1re éd. 1972), 350 p. (ISBN 978-1-900924-23-8).

- Robert Shelton (trad. Jacques Vassal), Bob Dylan sa vie et sa musique. « Like a Rolling Stone », Albin Michel, coll. « Rock & folk », , 556 p. (ISBN 978-2-226-02885-3).

- Bob Dylan (trad. Jean-Luc Piningre), Chroniques, volume 1, éditions Fayard, , 316 p. (ISBN 978-2-213-62340-5).

- Julien Gautier, Bob Dylan, un génie en liberté, Paris, Publibook, , 162 p. (ISBN 978-2-7483-5295-5).

- (en) Greil Marcus, Bob Dylan : Writings 1968-2010, Faber & Faber, .

- p. XVIII-XX.
Autres notes et références
- (en) « Elston Gunnn », Expecting Rain.
- (en) « Blind Boy Grunt », sur answers.com.
- (en) Nigel Williamson, The Rough Guide to Bob Dylan, Rough Guides Ltd, , 1re éd., 400 p. (ISBN 978-1-84353-139-5), p. 7.
- (en) D. Kamp et S. Daly, The Rock Snob's Dictionary, , p. 148.
- (en) Dylan coécrit le film Masked and Anonymous sous le pseudonyme Sergei Petrov, Michael Gray, The Bob Dylan Encyclopedia, Continuum International Publishing, , 736 p. (ISBN 978-0-8264-6933-5), p. 453.
- (en) Dylan produit les albums Love and Theft and Modern Times sous le pseudonyme Jack Frost, Michael Gray, The Bob Dylan Encyclopedia, Continuum International Publishing, , 736 p. (ISBN 978-0-8264-6933-5), p. 556.
- « Pat Garrett et Billy le Kid (1973) » (consulté le ).
- Claude Fleouter, « Bob Dylan reprend la route .. », sur Le Monde, .
- Claude Fleouter, « Dylan », sur Le Monde, .
- « Chronologie de la vie de Bob Dylan » (consulté le ).
- « Biographie de Bob Dylan » (consulté le ).
- « Bob Dylan », sur Les Inrocks, (consulté le ).
- « Renaldo and Clara (1978) ».
- Live 1975, The Rolling Thunder Revue, 2002.
- « Hurricane by Bob Dylan », sur Songfacts.com (consulté le ).
- « Le chanteur de légende se (re)lance dans les cantiques », Gala, .
- http://www.bobdylan-fr.com/trad/slowtrain.html.
- p. 334-336.
- (en) Adam R. Holz, « The Swingin' 1970s », Pluggedin, .
- « Slow Train Coming - Bob Dylan », sur AllMusic (consulté le ).
- (en) « Dylan and Lennon », The New York Times, .
- Bob Dylan (trad. Jean-Luc Piningre), Chroniques, vol. 1, Paris, Fayard, , 316 p. (ISBN 978-2-213-62340-5, OCLC 491269765).
- dylanologue - Michael Gray.
- Howard Sounes - Down the Highway: The Life of Bob Dylan, en 2001, pp. 354–356.
- (en) « Bob Dylan With The Grateful Dead » (consulté le ).
- « Bob Dylan - « Oh mercy » » (consulté le ).
- « Bob Dylan », sur olympiahall.com (consulté le ).
- « The History of the Traveling Wilburys », sur travelingwilburys.com (consulté le ).
- 2008 Pulitzer Prize Winners - SPECIAL CITATION, Citation.
- Voir sur 'lexpress.fr..
- Page du prix Nobel de littérature 2016..
- Yoko Trigalot, « Bob Dylan, trop occupé pour aller récupérer son Nobel de littérature », Le Figaro, (lire en ligne, consulté le ).
- « Bob Dylan, prix Nobel de littérature 2016 », Le Monde.fr, (ISSN 1950-6244, lire en ligne, consulté le ).
- https://www.ouest-france.fr/culture/prix-nobel-un-academicien-blame-bob-dylan-pour-son-arrogance-4575033.
- Sara Danius, sur l'antenne suédoise de Sveriges Radio.
- franceinfo, « Remise des Prix Nobel sans Bob Dylan mais avec Patti Smith », sur Francetvinfo.fr, Franceinfo, (consulté le ).
- « Bob Dylan a transmis son discours d’acceptation du prix Nobel », sur lemonde.fr, (consulté le )
- (en) Alex Gallagher, « Bob Dylan announces new album Rough and Rowdy Ways, shares single False Prophet », sur New Musical Express,
- (en) Brian Hiatt, « Bob Dylan Previews New Album Rough and Rowdy Ways with False Prophet », sur Rolling Stone,
- Martin Vaudorne, « Bob Dylan : son nouvel album, Rough and Rowdy Ways sortira en juin », sur Rock & Folk,
- https://www.journaldemontreal.com/2020/12/07/universal-music-achete-les-droits-de-toutes-les-chansons-de-bob-dylan-1
- Didier Plowy, « Bob Dylan reçoit sa Légion d'honneur », (consulté le )
- Robert Shelton, Bob Dylan sa vie et sa musique : Like a Rolling Stone.
- (en) www.bobdylan.com: Peter Stone Brown on Dylan at Newport.
- (en) An Open Letter to Bob Dylan, Irwin Silber (en), Sing Out!, novembre 1964 [lire en ligne].
- renommée plus tard en It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry.
- J’ai fait ce truc de dingue. Je ne savais pas ce qui allait se passer, mais le public a hué. Et pas qu’un peu. Ça sifflait de tous les côtés – Bob Dylan (voir Mark Blake, Mojo (Trad. Isabelle Chelley, Jean-Pierre Sabouret), Dylan : Visions, portraits, and back pages [« Dylan : Portraits et témoignages »], Tournon, 11/09/2006 (ISBN 235144017X)).
- Bruno Lesprit, « Scandales du XXe siècle. Dylan s'électrifie », Le Monde, (lire en ligne).
- « Joue du folk !… Remboursez !… C'est un festival folk !… Débarrasse-toi de ce groupe ! ».
- Organiser un Festival: veines et déveines de George Wein.
- Nick Kent, « L'année où Bod Dylan a disjoncté », Libération, (lire en ligne).
- Sylvain Siclier, « Levon Helm, musicien, chanteur, batteur de The Band, mort à 71 ans », Le Monde, (lire en ligne).
- Pascal Bouaziz, « Anatomie d’une voix », Télérama, no Hors-Série Dylan is Dylan, .
- Daniel Ichbiah, Et Dieu créa les Beatles, Scrineo, (lire en ligne).
- Subterranean Homesick Blues - Bringing It All Back Home (1965).
- Sylvain Bourmeau et Greil Marcus, « Il était lui-même l’histoire de la musique », Libération, (lire en ligne).
- (en) « I remember children's faces best… », sur Folk fan.
- Michael Gray, The Bob Dylan Encyclopedia, Continuum International Publishing, , 736 p. (ISBN 978-0-8264-6933-5), p. 198-200.
- « Biographie de Bob Dylan », sur Pure People.
- « Biographie de Bob Dylan », sur Bobdylan.fr.
- (en) Michael Gray, The Bob Dylan Encyclopedia, Continuum International Publishing, , 736 p. (ISBN 978-0-8264-6933-5), p. 174-175.
- (en) Michael Gray, The Bob Dylan Encyclopedia, Continuum International Publishing, , 736 p. (ISBN 978-0-8264-6933-5).
- (en) www.bjorner.com: Still On The Road: 2006 Us Summer Tour.
- la peinture de Bob Dylan, Exposition The Brazil Series, 2010.
- « Des peintures de Bob Dylan exposées pour la première fois à New York », Le Point, (lire en ligne).
- (en) Bob Dylan at the National Gallery of Denmark.
- Bob Dylan : The Brazil Series.
Voir aussi
Bibliographie
Travaux universitaires en français
- Jean-Pierre Ancèle sous la direction de Laurette Veza, Bob Dylan, une voix américaine : étude thématique et stylistique des chansons de 1962 à 1978. Thèse de doctorat en études nord-américaines, Paris 3, 1982, 387 p.
- Pascal Bert, Dylan acteur-témoin d’une décennie de révolte, 1960-1970. Mémoire de fin d’études à l’IEP de Bordeaux, 1979, 142 p. + annexes.
- Baptiste Fabre, La figure du vagabond dans la littérature et la chanson populaire américaines à travers les œuvres de Jack London, Woody Guthrie, Jack Kerouac et Bob Dylan. Mémoire de recherche à l’IEP de Bordeaux, 2002, 109 p.
- Ebenezer Brouzakis sous la direction de Jean-Louis Genard, Chimes of Freedom : Au cœur de la contestation, quels liens entre Bob Dylan et la politique américaine des années 60 ? Analyse de morceaux choisis. Mémoire de licence en sciences politiques et relations internationales, Université libre de Bruxelles (Belgique), 2002, 90 p. + 20 p. de lyrics.
- Christophe Lebold sous la direction de Claire Maniez, Écritures, masques et voix : Pour une poétique des chansons de Leonard Cohen et Bob Dylan. Thèse de doctorat en langues vivantes, Université Marc Bloch, Strasbourg 2, 2004, 493 p.
Livres en français
- Mark Blake et Mojo (trad. Isabelle Chelley et Jean-Pierre Sabouret, préf. Bono), Dylan : portraits & témoignages [« Dylan : visions, portraits and back pages »], Paris, Tournon, , 288 p. (ISBN 978-2-35144-017-9, OCLC 470709947)
- François Bon, Bob Dylan : Une biographie, Paris, Albin Michel réédité chez Livre de poche en 2009 avec une postface inédite, , 486 p. (ISBN 978-2-226-17936-4)Tiré de cette biographie, un feuilleton radiophonique diffusé sur France Culture en 2007 puis février 2010.
- Jean-Paul Bourre, Bob Dylan, Vivre à plein, Cerf, coll. « L’histoire à vif », , 150 p. (ISBN 2-204-02501-1)
- Dora Breitman, Demain j'ai rendez-vous avec Bob Dylan, Paris, Maurice Nadeau, , 218 p. (ISBN 978-2-86231-225-5)
- (en) Luke Crampton, Dafydd Rees et Wellesley Marsh (trad. de l'anglais par Alice Pétillot), Bob Dylan, Hong Kong/Köln/Paris etc., Taschen France, coll. « Music Icons », , 192 p. (ISBN 978-3-8365-1126-1)Édition trilingue.
- Bob Dylan (trad. Dashiell Hedayat), Tarantula suivi de « Portrait de l’artiste en pop star », UGE 10-18, 1973, réédité en 1993, 186 p. (ISBN 978-2-264-00009-5 et 2-264-00009-0)
- Bob Dylan (trad. Daniel Bismuth), Tarantula, Hachette Littératures, , 232 p. (ISBN 978-2-01-235582-8)Texte intégral.
- Bob Dylan et Jonathan Cott (trad. de l'anglais par Denis Griesmar), Dylan par Dylan : Interviews 1962-2004, Paris, Bartillat, , 557 p. (ISBN 978-2-84100-417-1)
- François Ducray, Philippe Manœuvre, Hervé Muller et Jacques Vassal, Dylan, Paris, A. Michel, coll. « Rock & folk », (réimpr. mise à jour en 1978) (ISBN 978-2-226-00127-6, OCLC 1503898)
- Daniel Mark Epstein (trad. de l'anglais par Philippe Paringaux), La ballade de Bob Dylan, Paris, Laffont, , 537 + 8 p. de photos (ISBN 978-2-221-12572-4)
- Andy Gill (trad. de l'anglais par Jacques Collin), Bob Dylan 1962-1969 : l’intégrale des années 60, Paris, Hors collection, , 144 p. (ISBN 2-258-05088-X)
- Michael Gross et Robert Alexander (trad. Marie Aufaure et Jacques-Émile Deschamps), Bob Dylan : une histoire illustrée [« Bob Dylan : an illustrated history »], Albin Michel, coll. « Rock & folk », , 159 p. (ISBN 978-2-226-00905-0, OCLC 77372751)
- Thomas Karsenty-Ricard, Dylan, l'authenticité et l'imprévu, L'Harmattan, coll. « Logiques sociales », , 104 p. (ISBN 978-2-7475-9151-5)
- Stéphane Koechlin, Bob Dylan : épitaphes 11, Paris, Flammarion, coll. « Pop culture », , 500 p. (ISBN 978-2-08-068507-0, OCLC 418501063)
- Greil Marcus (trad. de l'anglais par Thierry Pitel), Like a Rolling Stone : Bob Dylan à la croisée des chemins, Paris, Galaade, , 312 p. (ISBN 978-2-7578-0391-2)Réédité chez Points en 2007, titre et sous-titre intervertis.
- Nicolas Rainaud, Figures de Bob Dylan, Marseille, Le mot et le reste, coll. « Formes », , 207 p. (ISBN 978-2-915378-84-9)
- Alain Rémond, Les chemins de Bob Dylan, Paris, ÉPI, , 190 p. (ASIN B007CK4X6I)
- Alain Rémond, Et puis un jour j'ai entendu Bob Dylan, Paris, JBZ, , 199 p. (ISBN 978-2-7556-0710-9, OCLC 711831075)
- Anthony Scaduto (trad. Dashiell Hedayat, postface Hervé Muller), Bob Dylan, Paris, C. Bourgois, (1re éd. [V.O. 1972]), 510 p. (ISBN 978-2-267-00350-5, OCLC 301541413)
- Harry Shapiro (trad. de l'anglais par Christian Séruzier), Dylan : images de sa vie, Paris, Hugo & Cie, , 256 p. (ISBN 978-2-7556-0870-0)
- Sam Shepard (trad. Bernard Cohen, ill. Ken Regan), Rolling Thunder : Sur la route avec Bob Dylan, Éditions Naïve, , 209 p. (ISBN 978-2-35021-018-6).
- Silvain Vanot, Bob Dylan, Paris, Librio, 2001, 96 p. (Librio musique)
- Nigel Williamson (trad. de l'anglais par Frédéric Valion), Bob Dylan, Paris, Tournon, coll. « L'essentiel sur… », , 325 p. (ISBN 978-2-35144-095-7)
Livres en anglais
- (en) John Bauldie, Wanted Man : In Search of Bob Dylan, Black Spring Press, , 224 p. (ISBN 978-0-948238-10-9).
- (en) Bob Dylan, Bob Dylan Little Black Songbook, Wise Publications, coll. « Little Black Song Book », , 176 p. (ISBN 978-1-84609-492-7).
- (en) Andy Gill, Classic Bob Dylan : My Back Pages, Carlton Books, , 144 p. (ISBN 978-1-85868-481-9).
- (en) Michael Gray, The Bob Dylan Encyclopedia, Continuum International Publishing, , 736 p. (ISBN 978-0-8264-6933-5).
- (en) David Hajdu, Positively 4th Street : The Lives and Times of Joan Baez, Bob Dylan, Mimi Baez Farina, and Richard Farina, Bloomsbury, , 336 p. (ISBN 978-0-7475-5826-2).
- (en) Clinton Heylin, Bob Dylan : Behind the Shades : 20th Anniversary Edition, Faber and Faber, (ISBN 978-0-571-27240-2).
Autres sources
- Martin Scorsese, No Direction Home, Paramount Pictures (2005, 2 dvd)
- (en) Bob Dylan: A Distinctive Stylist ; Robert Shelton ; The New York Times, 29 septembre 1961, [lire en ligne]
- (en) Dylan goes electric – Robert Shelton, No Direction Home: The Life and Music of Bob Dylan, New York, 1986 [lire en ligne] (reproduction partielle)
- (en) An Open Letter to Bob Dylan, Irwin Silber (en), Sing Out!, novembre 1964 [lire en ligne]
- (en) Bjorner.com: Still On The Road: 2006 Us Summer Tour.
- (en) Come Writers And Critics Tous les livres, magazines, fanzines… consacrés à Bob Dylan dans le monde.
- (en) The Myth of Newport '65 – Bruce Jackson, 26 août 2002
- (en) BBC.co.uk: Madhouse On Castle Street - Bob Dylan à Londres en décembre 1962
- (en) Profiles: The Crackin’, Shakin’, Breakin’ Sounds – Nat Hentoff, The New Yorker, 24 octobre 1964
- (en) Bobdylan.com - Peter Stone Brown on Dylan at Newport
- (en) Bob Dylan: The Rolling Stone Interview. The rock & roll poet reflects on life, love, politics and God - Kurt Loder, Rolling Stone, 21 juin 1984
- (fr) Traduction des textes de Bob Dylan en français
- (fr) Al Grossman, un « spin doctor » de l’industrie du disque, Le Zinc, 10 octobre 2012
- (fr) Dylan, naissance d'une icône, Le Zinc, 24 août 2011
- (fr) Dylan s’électrifie – Bruno Lesprit, Le Monde, 24 août 2006
- (fr) Bob Dylan, hors série n° 23 Les Inrocks, 2007, 100 p., avec 1 cd
- (fr) Bob Dylan : À la poursuite d'une légende, hors série Le Monde, 2011, 124 p.
- (fr) Bob Dylan, hors série n° 3 Rolling Stone, 2009
- (fr) Dylan is Dylan, hors série Télérama, 2012, 100 p.
Exposition consacrée à Bob Dylan
- 2012 : « Bob Dylan, l'explosion rock 61-66 », Paris, Cité de la musique, du 6 mars au 15 juillet 2012
Articles connexes
Liens externes
- (en) Site officiel
- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :
- Ressources relatives à la musique :
- Ressources relatives aux beaux-arts :
- Ressources relatives à l'audiovisuel :
- Ressources relatives au spectacle :
- Ressources relatives à la littérature :
- Ressource relative à plusieurs domaines :
- Ressource relative à la bande dessinée :
- (en) Biographie sur le site de la fondation Nobel (le bandeau sur la page comprend plusieurs liens relatifs à la remise du prix, dont un document rédigé par la personne lauréate — le Nobel Lecture — qui détaille ses apports)
- (en) Come Writers And Critics, liste de toutes les publications papier
- Bob Dylan
- Auteur-compositeur-interprète américain
- Chanteur américain du XXe siècle
- Chanteur de rock américain
- Chanteur de folk américain
- Chanteur américain du XXIe siècle
- Chanteur des années 1970
- Chanteur des années 1980
- Chanteur des années 1990
- Guitariste de rock américain
- Guitariste jouant sur Gibson
- Harmoniciste de rock
- Harmoniciste américain
- Poète américain du XXe siècle
- Militant américain contre la guerre du Viêt Nam
- Artiste de Columbia Records
- Artiste d'Asylum Records
- Membre du Rock and Roll Hall of Fame
- Docteur honoris causa de l'université de Princeton
- Docteur honoris causa de l'université de St Andrews
- Lauréat du Grammy Award
- Lauréat du prix Pulitzer de musique
- Lauréat du Songwriters Hall of Fame
- Lauréat du prix Nobel de littérature
- Lauréat du prix Nobel absent à la cérémonie
- Lauréat américain du prix Nobel
- Lauréat du prix Princesse des Asturies en arts
- Hollywood Walk of Fame
- Parolier ayant remporté un Oscar de la meilleure chanson originale
- Membre de l'Académie américaine des arts et des sciences
- Membre de l'Académie américaine des arts et des lettres
- Membre de l'Académie des arts de Berlin
- Chevalier de la Légion d'honneur
- Commandeur des Arts et des Lettres
- Récipiendaire de la médaille présidentielle de la Liberté
- Nom de scène
- Naissance en mai 1941
- Naissance à Duluth (Minnesota)
- Éponyme d'un objet céleste


